- Accueil
- Par thème
- Jésus
- Il y a de multiples preuves de la Résurrection du Christ
- Le Christ a donné toutes les preuves divines qui convenaient (cf. SCLG n°6)
- La sublimité de la Parole du Christ
- Le trilemme de Lewis : une preuve de la divinité de Jésus
- L'autorité divine du Christ, dont le seul nom chasse les démons
- Dieu sauve : la puissance du saint nom de Jésus
- Jésus, l'homme qui parlait et agissait comme l'égal de Dieu
- La vérité de Jésus transparaît même dans le Coran
- La grandeur sublime de la Passion du Christ
- Le seul homme dont on témoigne au prix de la vie qu'il est ressuscité des morts
- Jésus est venu au meilleur moment pour façonner l’histoire de l’humanité
- Les sources rabbiniques rendent témoignage aux miracles de Jésus
- Marie
- L'Eglise
- La propagation miraculeuse du Christianisme
- La conversion de l’Empire romain au christianisme (392)
- L'Eglise catholique et son magistère existent depuis près de 2000 ans
- Le Magistère infaillible de l'Eglise
- Le concept de Révélation suppose le concept de Magistère
- Le trésor de la doctrine sociale de l'Eglise
- Les innombrables « sceaux de Dieu » recueillis par le Dicastère pour la cause des saints
- Humane Vitae, un argument frappant en faveur du catholicisme (1968)
- La Bible
- La prophétie du Temple détruit est stable, malgré Julien l’Apostat
- Les auteurs des Évangiles sont des témoins oculaires ou de proches associés
- L’onomastique est en faveur de la fiabilité historique des Évangiles
- Le Nouveau Testament n’a pas été corrompu
- Le Nouveau Testament est le manuscrit le mieux attesté de l’Antiquité
- Les Évangiles ont été écrits trop tôt pour être des légendes
- Le Nouveau Testament est fiable, c’est l’archéologie qui le dit
- Le critère d’embarras prouve que les Évangiles ne peuvent pas être un mensonge
- Le critère de dissimilarité renforce la fiabilité des Évangiles
- 84 détails du livre des Actes des apôtres sont confirmés par l’histoire et l’archéologie
- D'extraordinaires prophéties annonçaient la venue du Messie
- Le temps de la venue du Messie a aussi été précisément prophétisé
- La peinture ultraréaliste des tortures du Messie par le prophète Isaïe
- Le prophète Daniel a annoncé un « fils d’homme » qui est le portrait du Christ
- Rapidité et fiabilité de la genèse des Evangiles
- Les Apôtres
- Saint Pierre, chef des apôtres (+64)
- Saint André, le premier des apôtres appelés par Jésus (+45)
- Saint Jacques le Majeur, premier apôtre martyr (+41)
- Saint Jean l’évangéliste, apôtre et « Théologien » : un géant trop méconnu (+100)
- Saint Philippe (+85)
- Saint Barthélémy (+47)
- Saint Thomas, du doute à la Chine (+72)
- Saint Matthieu, apôtre, évangéliste et martyr (+61)
- Jacques le Juste, « frère » du Christ, apôtre et martyr (+62)
- L’apôtre saint Jude, témoin véridique de la vie de Jésus (+65)
- Saint Simon le Zélote (+60)
- Saint Matthias devenu apôtre après la mort de Jésus (+63)
- Les martyrs
- Saint Jean-Baptiste (+29)
- Saint Étienne, premier des martyrs (+31)
- Rome brûle, l’Évangile perdure (64)
- Polycarpe, évêque de Smyrne, disciple de Jean et martyr (+155)
- Justin de Naplouse, apologète et martyr (+165)
- Sainte Blandine et les Martyrs de Lyon, la force de la foi (+177)
- Apollonius aime la vie, mais la vraie, la vie éternelle (+185)
- Sainte Martine : « Celle-là, Dieu sait son nom. » (+IIIe s)
- Sainte Cécile (+230)
- Saint Saturnin, mis à mort en étant traîné par un taureau (+250)
- Sainte Agathe sauve la ville de Catane de la lave (+251)
- Tarcisius, martyr de l’Eucharistie (+257)
- Alban, de la conversion au martyre (+288)
- Dieu protège la virginité d’Agnès qui s’est consacrée à lui (+305)
- Sainte Lucie de Syracuse, vierge et martyre pour Jésus-Christ (+304)
- Afra, de la prostitution au martyre (+305)
- Sainte Marguerite d’Antioche (+305) apparaît à Jeanne d’Arc pour la préparer à sa mission
- Sainte Julienne de Nicomédie (IVème siècle)
- Ils préfèrent mourir de froid plutôt que de renier le Christ : les quarante martyrs de Sébaste (+320)
- Saint Boniface sème la parole en Germanie (+754)
- La révolte pacifique des catholiques de Cordoue (850)
- Solange, martyre de la pureté (+878)
- Dieu fait d’un lâche un héros de la foi (+1460)
- Thomas More, « bon serviteur du roi, et de Dieu en premier » (+1535)
- Thomas Plumtree meurt ici-bas pour ne pas mourir à la vie divine (+1570)
- Le martyre de Paul Miki et de ses compagnons (+1597)
- Anne Line, pendue pour avoir caché des prêtres (+1601)
- Oliver Plunkett, « coupable de promouvoir la foi catholique » (+1681)
- « C’est lui que j’aime et je suis prête à mourir pour lui » : la néo-martyre Kyranna (+1751)
- Filles de la Charité, elles prédisent la fin des persécutions (+1794)
- Les martyrs d’Angers et d’Avrillé (+1794)
- La dernière messe de Noël Pinot (+1794)
- Les seize Carmélites martyres (+1794)
- À Orange, le Christ accompagne les religieuses jusqu’à l’échafaud (+1794)
- Le père Dung Lac et ses 116 compagnons martyrs au Vietnam (XVIIe - XIXe)
- Angélis de Chio, la folie du martyre (+1813)
- Il brave les supplices pour expier son apostasie (+1818)
- Jésus rend la foi à Jean-Gabriel Perboyre (+1838)
- Blaise Marmoiton, l'épopée d'un missionnaire au bout du monde (+1847)
- Double peine pour le père Chapdelaine (+1856)
- Dominique Cam ne piétine pas la croix, mais l’embrasse (+1859)
- Siméon-François Berneux, le prêtre sarthois devenu évêque et martyr en Corée (+1866)
- Les martyrs d’Ouganda ou l’éternelle répétition des persécutions (1885)
- Miguel Pro, icône du Christ (+1927)
- Mort à 14 ans pour le Christ Roi, José Luis Sanchez del Rio (+1928)
- Le témoignage des sept martyrs de Songkhon (1940)
- Saint Maximilien Kolbe, le chevalier de l’Immaculée (+1941)
- Franz Jägerstätter : il ne pouvait pas être catholique et nazi (+1943)
- Anna Kolesarova, « hostie de la sainte chasteté » (+1944)
- Mgr Janos Scheffler, le pardon aux bourreaux (+1952)
- Stepinac dit non à Tito et reste fidèle à l’Église de Jésus-Christ (+1960)
- La vie offerte des moines de Tibhirine (+1996)
- « Frères à la vie, frères à la mort » (+1997)
- Les moines
- Les Pères du désert (IIIe siècle)
- Saint Antoine du désert, le « père des moines » (+356)
- Saint Benoît, patriarche des moines d’Occident (+550)
- Le Mont Athos (Xème siècle)
- Un abbé en prière pour son siècle : Mayeul de Cluny (+994)
- Saint Bruno le Chartreux, miracle de la vie cachée (+1101)
- Le bienheureux Ange-Augustin Mazzinghi, carme couronné de fleurs (+1438)
- Antonin de Florence : moine, prophète et archevêque (+1459)
- Frère Corradino donne tout et mendie pour donner davantage (+1468)
- Capucin thaumaturge, bienheureux Marc d’Aviano (+1699)
- Les prophéties réalisées du moine Abel pour la Russie (+1841)
- Nimatullah Al-Hardini, empli de la grâce de Dieu (+1858)
- Les 29 349 miracles de saint Charbel Maklouf (+1898)
- La prière perpétuelle de Silouane de l’Athos (+1938)
- Saint Padre Pio : les merveilles de Dieu à travers un humble frère qui prie (+1968)
- La mort étonnante du père Emmanuel de Floris (+1992)
- Les prophéties du père Païssios, du mont Athos (+1994)
- L’extraordinaire frère Toufik (+2021)
- Les saints
- La « légende » des saints n’est pas un mythe
- Sainte Anne et saint Joachim, parents de la Vierge Marie (-19)
- Saint Jean-Baptiste, témoin du Christ annoncé par les prophètes (+28)
- Saint Nazaire, apôtre et martyre (+68 ou 70)
- Ignace d’Antioche : successeur des apôtres et témoin de l’Évangile (+117)
- Saint Grégoire le Thaumaturge (+270)
- Gatien, apôtre de la Touraine (IIIe s)
- Saint Martin de Tours, père de la France chrétienne (+397)
- La grande conversion de Fabiola (+399)
- Mélanie la Jeune : par le chas d’une aiguille (+439)
- Syméon monte sur une colonne pour demeurer seul avec le Christ (+459)
- Sainte Geneviève, patronne de Paris (+502)
- Saint Avit de Vienne affirme la divinité de Jésus (+518)
- Saint Remi, l’évêque qui baptisa le roi des Francs (+533)
- Hilaire de Mende, un saint évêque thaumaturge (+540)
- Saint Augustin de Cantorbéry apporte la bonne nouvelle sur la terre des Angles (+604)
- Saint Loup, l’évêque qui fit rebrousser chemin à Attila (+623)
- Saint Ildefonse de Tolède, défenseur de la Vierge Marie (+667)
- Née aveugle, sainte Odile retrouve la vue lors de son baptême (+720)
- Saint Rainer de Pise : la conversion miraculeuse d’un riche négociant (+1160)
- Saint Dominique de Guzman, athlète de la foi (+1221)
- Saint François, le pauvre d’Assise (+1226)
- Saint Antoine de Padoue, le « saint que tout le monde aime » (+1231)
- Sainte Rose de Viterbe : comment la prière change le monde (+1252)
- Saint Simon Stock reçoit le scapulaire du Mont Carmel (+1265)
- L’étrange barque de saint Basile de Riazan (+1295)
- L’absolue confiance en Dieu de sainte Agnès de Montepulciano (+1317)
- Sainte Élisabeth du Portugal, une rose en royauté (+1336)
- L’extraordinaire conversion de Micheline de Pesaro (+1356)
- Le mariage virginal de bienheureuse Delphine de Sabran (+1360)
- Saint Pierre Thomas : une confiance en la Vierge Marie à toute épreuve (+1366)
- Jeanne-Marie de Maillé traverse les humiliations et la misère accompagnée par la Vierge Marie (+1414)
- Saint Vincent Ferrier, mirificus praedicator (+1419)
- Les prodigieux sermons de Bernardin de Sienne (+1444)
- Sainte Rita de Cascia, celle qui espère contre toute espérance (+1457)
- Jacques de la Marche transmet la foi catholique à travers l’Europe (+1476)
- Dieu parle par la bouche de la bienheureuse Madeleine de Panattieri (+1503)
- Sainte Catherine de Gênes, ou le feu de l’amour de Dieu (+1510)
- Saint Antoine-Marie Zaccaria, médecin des corps et des âmes (+ 1539)
- Saint Ignace de Loyola : à la plus grande gloire de Dieu (+1556)
- Pierre d’Alcantara, à qui Dieu ne refuse rien (+1562)
- Saint Pascal Baylon, la gloire mondiale d’un humble berger (+1592)
- Saint Bernardin Realino répond à l’appel divin (+1616)
- Alphonse Rodriguez, le saint portier jésuite (+1617)
- Martin de Porrès revient hâter sa béatification (+1639)
- Virginia Centurione Bracelli : quand toutes les difficultés s’aplanissent (+1651)
- Sainte Marie de l’Incarnation, « la sainte Thérèse du Nouveau Monde » (+1672)
- Jean Eudes, époux du Cœur Immaculé de Marie (+1680)
- Kateri Tekakwitha, une sainte chez les Mohawks (+1680)
- Claude La Colombière prédit son emprisonnement (+1682)
- Saint François de Laval : père de l’Église canadienne (+1708)
- François de Girolamo lit les cœurs (+1716)
- Rosa Venerini ou la parfaite volonté de Dieu (+1728)
- Le succès étonnant des prédications de saint Ange d’Acri (+1739)
- Le pacte de la comtesse Molé avec la Croix de Jésus-Christ (+1825)
- Jeanne-Antide Thouret : partout où Dieu voudra l’appeler (+1826)
- Lorsque le moine Seraphim contemple le Saint-Esprit (+1833)
- Gaspard del Bufalo, le prêtre qui a dit non à Napoléon (+1837)
- La confiance en Dieu de sainte Marie-Madeleine Postel (+1846)
- Camille de Soyécourt, comblée par Dieu de la vertu de force (+1849)
- Bernadette Soubirous, bergère qui vit la Vierge (1858)
- Saint Jean-Marie Vianney, la gloire mondiale d'un petit curé de campagne (+1859)
- Gabriel de l’Addolorata, le « jardinier de la Sainte Vierge » (+1862)
- Michel Garicoïts lève une armée contre l’Antéchrist (+1863)
- À Grenoble, le « saint abbé Gerin » (+1863)
- Antoine-Marie Claret, un tisserand devenu ambassadeur du Christ (+1870)
- Bienheureux Francisco Palau y Quer, un amoureux de l’Église (+1872)
- Thérèse Couderc remet tout entre les mains de Marie (+1885)
- Newman cherche la véritable Église du Christ (+1889)
- Les saints époux Louis et Zélie Martin (+1894)
- La vie en Jésus Christ de Jean de Cronstadt (+1908)
- Celina Chludzinska, une vie entre les mains de Dieu (+1913)
- La maturité surnaturelle de Francisco Marto, « consolateur de Dieu » (+1919)
- Saint André Bessette, serviteur de saint Joseph (+1937)
- Sainte Faustine, apôtre de la divine miséricorde (+1938)
- Mère Marie Skobtsova, une moniale hors du commun (+1945)
- Sainte Joséphine Bakhita, de la souffrance à l’amour (+1947)
- Frère Marcel Van, une « étoile s’est levée en Orient » (+1959)
- Sainte Gianna Beretta Molla donne la vie, au prix de la sienne (+1962)
- Carlo Acutis, faire-valoir de Jésus Hostie (+2006)
- Les docteurs
- Saint Irénée de Lyon, docteur de l’unité (+202)
- Saint Ambroise de Milan, évêque malgré lui (+397)
- Saint Jérôme, traducteur et interprète des Saintes Écritures (+420)
- Saint Augustin (+430)
- L’intelligence d’Isidore de Séville au service de la foi (+636)
- Saint Bernard, abbé de Clairvaux et docteur de l’Église (+1153)
- Saint Thomas d'Aquin (+1274)
- Saint Albert le Grand, les noces de l'intelligence et de la foi (+1280)
- Sainte Catherine de Sienne, épouse du Christ dans la foi (+1380)
- Thérèse d’Avila, piquée par le feu d’amour de Dieu (+1582)
- Pierre Canisius, défenseur de la foi catholique en Allemagne (+1597)
- Saint Robert Bellarmin, défenseur de la foi catholique (+1621)
- Saint François de Sales, docteur de l’Amour divin (+1622)
- Saint Louis-Marie Grignion de Montfort (+1716)
- Saint Alphonse de Liguori, l'œuvre surnaturelle d'un avocat (+1787)
- Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus (+1897)
- Les mystiques
- Sainte Lutgarde et la dévotion au Sacré Cœur (+1246)
- Sainte Gertrude de Helfta, touchée par la grâce divine (+1301)
- Sainte Angèle de Foligno et « dame pauvreté » (+1309)
- Dorothée de Montau, épouse, mystique et sainte (+1394)
- Les révélations reçues par Julienne de Norwich sur l’amour divin (+1416)
- La profonde vie mystique de Catherine Racconigi (+1547)
- Sainte Thérèse d'Avila (+1582)
- Saint Jean de la Croix, poète et psychologue universel (+1591)
- Saint Alphonse d’Orozco est emmené en esprit au Ciel (+1591)
- Sainte Rose de Lima, « un lys parmi les épines » (+1617)
- Bienheureuse Anne de Jésus, carmélite aux dons mystiques (+1621)
- Les visions de Marguerite de Beaune pour la France (1636)
- Les évanouissements du cœur de Maria Angela Astorch (+1665)
- Catherine Daniélou, témoin du Christ en Bretagne (+1667)
- Une fleur au milieu des ruines : Giovanna Maria Bonomo (+1670)
- Mère Maria Villani, épouse mystique de Jésus-Christ (+1670)
- Sainte Marguerite-Marie voit le « Cœur qui a tant aimé les hommes » (+1690)
- Jeanne Le Ber, la recluse de Ville-Marie (+1714)
- Jésus fait de Maria Droste zu Vischering la messagère de son Divin Cœur (+1899)
- Les prédictions de sœur Yvonne-Aimée concernant la Seconde Guerre mondiale (1922)
- Sœur Josefa Menendez, apôtre de la miséricorde divine (+1923)
- Édith Royer et le Sacré-Cœur de Montmartre (+1924)
- La vie mystique de Conchita, épouse et mère (+1937)
- Rozalia Celak, une mystique à la mission très spéciale (+1944)
- Sœur Consolata, en dialogue constant avec Jésus (+1946)
- Don Dolindo fait peindre le visage du Christ, tel qu’il l’a vu (+1970)
- Les extases de Myrna Nazzour (1983)
- Rolande Lefevre (+2000)
- Caterina Bartolotta, mystique d’aujourd’hui (XXIè s)
- Les visionnaires
- Sainte Perpétue délivre son frère du purgatoire (203)
- Anne-Catherine Emmerich
- Saint Malachie d’Armagh voit par trois fois l’âme de sa sœur morte (+1148)
- Les prophéties précises et exactes de la Vierge Marie à mère Mariana de Jesus Torres au sujet de l’Équateur (1599)
- Marie d’Agreda retranscrit la vie de la Vierge Marie (+1665)
- La découverte de la maison de la Vierge Marie à Éphèse (1891)
- Sœur Benigna Consolata, la « petite secrétaire de l’amour miséricordieux » (+1916)
- Quand les visions de Maria Valtorta coïncident avec les observations de l’Institut météorologique d’Israël (1943)
- Berthe Petit et ses prophéties relatives aux deux guerres mondiales (+1943)
- Maria Valtorta ne voit qu’une seule des pyramides de Gizeh… et à raison ! (1944)
- Le village de saint Pierre localisé par vision avant sa découverte archéologique (1945)
- Les 700 extraordinaires visions de l’Évangile reçues par Maria Valtorta (+1961)
- L’étonnante exactitude géologique des écrits de Maria Valtorta (+1961)
- Les observations astronomiques des écrits de Maria Valtorta confirmées (+1961)
- Découverte anticipée par vision mystique d’une maison princière à Jérusalem (+1961)
- Les tours de Jezreel dans les écrits de Maria Valtorta (+1961)
- Mariette Kerbage, la voyante d’Alep (1982)
- Les prophéties révélées à sœur Marie-Nathalie Kovacsics (+1992)
- Les 20 000 icônes de Mariette Kerbage (2002)
- Les papes
- L’Esprit Saint désigne Fabien comme nouveau pape (236)
- Saint Jean Ier, pape et martyr (+526)
- Saint Silvère, un pape contre les hérétiques (+537)
- Saint Grégoire le Grand, modèle des papes (+604)
- Saint Célestin V : à 84 ans, rien ne le prédestinait à devenir Pape (+1296)
- Saint Pie X (+1914)
- Le bon pape, saint Jean XXIII (+1963)
- Saint Jean-Paul II (+2006)
- Les grands témoins de la foi
- Domitille : princesse romaine chrétienne du Ier siècle (+1er s)
- La conversion de saint Augustin : « Combien de temps remettrai-je à demain ? » (386)
- François de Sienne confie tout à la Vierge Marie et lui livre son cœur (+1328)
- Tommaso de Vio, dit Cajétan, une vie au service de la vérité (+1534)
- Madame Acarie ou le « livre vivant de l’amour de Dieu » (+1618)
- Pascal et la révélation des prophètes (+1662)
- Madame Élisabeth, ou le parfum des vertus (+1794)
- Les époux Beltrame : tout entre les mains de Dieu (1913)
- Jacintha, 10 ans, offre ses souffrances pour sauver des âmes de l’enfer (+1920)
- Anne de Guigné, la petite fille qui parlait à Jésus (+1922)
- Le père Jean-Édouard Lamy, un « second curé d’Ars » (+1931)
- Monseigneur von Galen, « le Lion de Münster » (+1946)
- Ce qui a fait persévérer Marie Noël dans la foi (+1967)
- La mission de Maria Gargani : faire aimer le cœur de Jésus (+1973)
- Claire de Castelbajac transfigurée par la joie de Dieu (+1975)
- Le vagabond de Dieu, John Bradburne (+1979)
- L’offrande de Chiara Luce au Christ (+1990)
- La mission de Lucie Dos Santos après Fatima (+2005)
- l'Abbé Georges Lemaître
- La civilisation chrétienne
- La profondeur de la spiritualité chrétienne
- Henri Bergson : « Le mysticisme complet est celui des chrétiens »
- Cohérence et force de la vie mystique chez Jean de la Croix
- Le christianisme offre une clé essentielle pour comprendre la nature humaine
- Le dogme de la Trinité : une vérité de mieux en mieux comprise
- L’incohérence des critiques contre le christianisme
- La loi de Dieu n’est pas arbitraire
- L’Esprit Saint se manifeste de nos jours comme en une « nouvelle Pentecôte »
- La foi chrétienne explique la diversité des religions
- L'imitation de Jésus-Christ
- Les images de la Sainte Trinité selon saint Augustin
- Les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, pour se tourner vers le Christ
- Le chemin de Saint Jacques de Compostelle
- Les miracles des pardons impossibles
- Le christianisme fut un moteur essentiel de l’abolition de l’esclavage
- Le cardinal Pierre de Bérulle sur le mystère de l’Incarnation (+1629)
- La théologie du corps de saint Jean-Paul II
- Les interventions du Christ dans l'Histoire
- Les apparitions et interventions mariales
- Notre Dame du Pilier vient redonner courage à l’apôtre Jacques à Saragosse (40)
- Le Puy-en-Velay (431)
- Une source à l'origine d'une multitude de miracles à Constantinople (457)
- Apparition, prophétie et guérisons de la Vierge Marie dans le Nord de la France (600)
- Plus de mille ans que Marie agit pour les hommes à Foggia (1001)
- Notre Dame des Vertus sauve la ville de Rennes (1357)
- Czestochowa, l’âme de la Pologne (1384)
- Marie fait arrêter l’épidémie de peste au mont Berico (1426)
- Notre Dame des miracles guérit un paralytique à Saronno (1460)
- Notre-Dame de Treize-Pierres, en Aveyron (1509)
- Cotignac, premières apparitions modernes de l'histoire (1519)
- La Vierge Marie porte la Bonne Nouvelle aux Indiens du Mexique (1531)
- Savone : la naissance d’un sanctuaire (1536)
- La Vierge Marie délivre les chrétiens de la cité de Cuzco au Pérou (1536)
- Notre Dame de l’Agenouillée (1550)
- La victoire de Lépante et la fête de Notre-Dame du Rosaire (1571)
- Les apparitions au frère Fiacre (1637)
- Le « vœu des échevins », ou la dévotion mariale des Lyonnais (1643)
- Notre Dame de Nazareth à Plancoët (1644)
- La Madone de Laghet (1652)
- Les apparitions de saint Joseph au Bessillon (1661)
- Les confidences du Ciel à la bergère du Laus (1664-1718)
- Notre Dame des Neiges au secours des soldats catholiques (1716)
- Zeitoun, un miracle de deux années (1968-1970)
- Le Saint Nom de Marie et la victoire décisive de Vienne (1683)
- Le ciel touche la terre en Colombie : Las Lajas (1754)
- Le « M » que Marie a tracé sur la France sera rappelé le 26 mai prochain (XIXe)
- Les 37 000 prières exaucées, gravées dans le marbre d’une basilique parisienne (XIXe)
- La Vierge apparaît et prophétise en Ukraine depuis le XIXe siècle (1806)
- La nuit extraordinaire de sœur Labouré (1830)
- « Consacre ta paroisse au cœur immaculée de Marie » (1836)
- A la Salette, Marie pleure près des bergers (1846)
- Les apparitions de Lourdes, d’authentiques expériences surnaturelles (1858)
- La Vierge Marie dans le Wisconsin : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » (1859)
- Pontmain (1871)
- Les quinze apparitions de Notre Dame à Pellevoisin (1876)
- Les apparitions de Gietrzwald, un secours extraordinaire en Pologne (1877)
- L'apparition silencieuse de Knock Mhuire en Irlande (1879)
- Cuapa : la Vierge est en Équateur (1980)
- Marie « Mère abandonnée » apparaît dans un quartier populaire de Lyon (1882)
- Les trente-trois apparitions de la Vierge Marie à Beauraing (1932)
- La « Vierge des pauvres » apparaît à huit reprises à Banneux (1933)
- Face à la Gestapo, elles soutiennent qu’elles ont vu la Vierge Marie (1937)
- La Rosa Mystica de Montichiari (1947)
- Marie répond au vœu des Polonais (1956)
- Ils sont des centaines de milliers à avoir vu la Vierge à Zeitoun en Égypte (1968)
- « Une Belle Dame » vient au secours de la France à l'Ile Bouchard (1947)
- Maria Esperanza et Notre-Dame Réconciliatrice des Peuples de Bétania (1976)
- Luz Amparo et les apparitions de l’Escorial en Espagne (1981)
- Les extraordinaires apparitions de Medjugorje et leur impact mondial (1981)
- La Vierge Marie prophétise les massacres au Rwanda (1981)
- Apparitions et message de la Vierge Marie à Myrna (1982)
- San Nicolas : lorsque Marie visite l’Argentine (1983)
- La Vierge Marie guérit un adolescent, avant de lui apparaître à Belpasso (1986)
- Seuca : l’appel de la « Reine de lumière » en Roumanie (1995)
- Les anges et leurs manifestations
- Les anges gardiens « pour te garder en toutes tes voies »
- Le Mont Gargano
- Le Mont Saint-Michel, ou comment le ciel veille sur la France
- La révélation de l’Axion estin par l’archange Gabriel (982)
- Des anges donnent une ceinture surnaturelle au chaste Thomas d’Aquin (1243)
- Françoise Romaine, le jeu du Ciel et de l’enfer (+1440)
- Les anges finissent la statue de Notre Dame du Bon Succès (1610)
- L’ange qui fait évader Mère Yvonne-Aimée de Malestroit (1943)
- Le sauvetage angélique des accidentés de l’autoroute 6 (2008)
- Les exorcismes au nom du Christ
- Une vague de charité unique au monde
- D'innombrables œuvres de charité
- D'innombrables œuvres d'éducation
- Saint Martin de Tours
- Saint Pierre Nolasque, apôtre de la liberté chrétienne (+1245)
- Rita de Cascia pardonne à l’assassin de son mari (1404)
- Sainte Angèle Mérici : pour servir, non être servie (+1540)
- Saint Jean de Dieu, ou Jésus au service des malades (+1550)
- Saint Camille de Lellis, réformateur des soins hospitaliers (vers 1560)
- Bienheureuse Alix Le Clerc, encouragée par Marie à créer des écoles (+1622)
- Saint Vincent de Paul, apôtre de la charité (+1660)
- Marguerite Bourgeoys, première enseignante de Montréal (+1700)
- Takashi Nagai
- Frédéric Ozanam, inventeur de la doctrine sociale de l’Église (+1853)
- Sainte Joaquina de Vedruna fonde les Carmélites de la Charité (+1854)
- Madame de l’Espérance (+1868)
- Damien de Molokai, missionnaire lépreux (+1889)
- Anne-Marie Adorni au service des prisonnières de Parme (+1893)
- Bienheureuse Josefa Naval Girbés (+1893)
- George Müller adresse ses demandes à Dieu seul (+1898)
- Thérèse-Adélaïde Manetti : une enfance pauvre, un riche héritage (+1910)
- Camille Costa de Beauregard, un père pour les orphelins de Chambéry (+1910)
- Pier Giorgio Frassati, la charité héroïque (+1925)
- Giuseppe Moscati, un saint en blouse blanche (+1927)
- Bienheureuse Irène, « Mère pitié » du Kenya (+1930)
- Mère Marie-Thérèse de Saint-Joseph, « un ange de réconfort et de paix » (+1938)
- Don Luigi Orione, stratège de la charité (+1940)
- Prince Ghika, alias « sœur Vladimir » (+1954)
- Maravillas de Jésus : une charité à l’échelle du monde (+1974)
- Akamasoa : « l’expression de la présence de Dieu au milieu de son peuple pauvre » (1989)
- Sœur Dulce, le « bon ange de Bahia » (+1992)
- Mère Teresa de Calcutta, une foi inébranlable (+1997)
- Heidi Baker : l’amour de Dieu au cœur des ténèbres
- Des miracles étonnants
- Le Linceul de Turin, témoin de la Passion et de la Résurrection du Christ
- Le Saint Feu de Jérusalem
- Dorothée reçoit des fruits et des fleurs du ciel (+304)
- Le miracle toujours recommencé du sang de saint Pantaléon (+305)
- Le miracle de la liquéfaction du sang de saint Janvier (+431)
- Le miracle des ardents (1130)
- Les miracles de saint Antoine de Padoue (+1231)
- Les multiplications surnaturelles de saint Yves pour les pauvres (+1303)
- Les panini benedetti de saint Nicolas de Tolentino (1447)
- Louis XI apprend à chercher l’éternité plutôt que la guérison (1483)
- Saint Pie V et le miracle du crucifix (1565)
- Une fleur inconnue pousse sur la fosse commune (1572)
- Saint Philippe Néri ressuscite un jeune mort (1583)
- La résurrection de Jérôme Genin (1623)
- Saint François de Sales ressuscite une enfant noyée (1623)
- Le bon père Fourier, un curé lorrain mémorable (+1640)
- Le miracle de Calanda : du moignon à la jambe (1640)
- Le rôti inépuisable de Marie-Thérèse de Lamourous (+1836)
- Saint Jean Bosco et la promesse d’outre-tombe (1839)
- Le jour où le Soleil dansa (1917)
- Un navire de guerre sauvé par le Saint Sacrement (1918)
- À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le signe annoncé par la Vierge Marie apparaît dans le ciel (1938)
- Pie XII et le miracle du soleil au Vatican (1950)
- Stanley Villavicencio, Lazare des temps modernes (1993)
- L'escalier de saint Joseph à Santa Fe
- Le sauvetage miraculeux de Charle par Charles (2016)
- Reinhard Bonnke : 89 millions de conversions (+2019)
- Guérisons miraculeuses
- Le toucher des écrouelles : un miracle de guérison pluriséculaire (XIe-XIXe)
- Réginald d’Orléans est guéri in extremis par la Vierge Marie (1218)
- Le miracle de l’épine (1656)
- Pauline Jaricot miraculeusement guérie par sainte Philomène (1835)
- Avec plus de 7500 dossiers de guérisons inexpliquées, Lourdes est unique au monde (1858)
- Confiante, Catherine Latapie plonge son bras dans la flaque boueuse (1858)
- Pierre de Rudder : une guérison spectaculaire par l’intercession de Notre Dame de Lourdes (1875)
- Estelle Faguette est guérie par la « toute miséricordieuse » (1876)
- Mariam, le « petit rien de Jésus » : une sainte de l'Orient à l'Occident (+1878)
- Saint Charbel guérit aux quatre coins du monde (+1898)
- La guérison miraculeuse de Marie Bailly et la conversion d’Alexis Carrel (1902)
- Gemma, guérie afin d’expier les fautes des pêcheurs (+1903)
- Notre Dame de Lourdes intervient loin du sanctuaire (1910)
- La terre du tombeau de sainte Rafqa (+1914)
- La guérison de Sœur Marie-Joséphine Catanea (+1948)
- Les os déformés de Briege sont redressés (1970)
- Électrocuté, le jeune pompier revient à la vie (1980)
- Guérie d’une maladie incurable, Maureen croit finalement aux miracles (1981)
- La guérison extraordinaire d’Alice Benlian en l’église Sainte-Croix de Damas (1983)
- Une fillette s’empoisonne, Edith Stein la sauve (1987)
- Du Ciel, Jeanne Jugan soulage encore les souffrances du prochain (1988)
- Le miracle survenu le jour de la béatification de Juan Diego Cuauhtlatoatzin (1990)
- « Pour que le monde croie, tes plaies s’ouvriront tous les 22 du mois » (1993)
- Un prêtre guéri par sainte Faustine, apôtre de la miséricorde divine (1995)
- La bienheureuse Marguerite Bays sauve une enfant (1998)
- Le miracle qui a conduit frère André sur les autels (1999)
- Guérison miraculeuse grâce à un message du Christ (2001)
- Le pape Jean-Paul Ier au chevet d’une fillette (2001)
- Le grand miracle de Luigi Guanella (2002)
- La repousse de l’intestin de Bruce Van Natta : un miracle irréfutable (2007)
- L’intercession miraculeuse de saint Ludovic Pavoni (2009)
- La chute aux conséquences inattendues d’Annabel Beam (2011)
- Le jour où il est béatifié, Jean-Paul II guérit une mère de famille (2011)
- Il avait « zéro » chance de vivre : la guérison miraculeuse d’un bébé (2015)
- Guérison d’un diacre par l’intercession du bienheureux Francesco Mottola (2010)
- Miracle aux urgences pédiatriques (2010)
- Sortie du coma par l’intercession de Pauline Jaricot (2012)
- Guérison de Shams, petite fille musulmane de Bagdad (2014)
- Manouchak, opérée par saint Charbel (2016)
- Le cancer de Maya, guérie sur le tombeau de saint Charbel (2018)
- L’espérance en Dieu, plus forte que le cancer (2024)
- Père Emiliano Tardif
- Damian Stayne
- Corps conservés des saints
- Mourir en odeur de sainteté
- Le corps de sainte Cécile, retrouvé intact (+230)
- Gildas : toutes les marques de la sainteté (+565)
- Saint Claude, vertueux dans la vie et dans la mort (+699)
- Saint Romuald, ermite et réformateur infatigable (+1027)
- Jean le Bon, l’ermite de Mantoue (+1249)
- Stanislas Kostka brûle d’amour pour Dieu (+1568)
- Sainte Germaine de Pibrac, la petite Cendrillon de Dieu (+1601)
- Bienheureux Antonio Franco, l’évêque défenseur des pauvres (+1626)
- Le repos de saint Dimitri de Rostov, pour les siècles des siècles (+1706)
- Giuseppina Faro, servante de Dieu et des pauvres (+1871)
- Don Gaspare Goggi, une « graine de saint » (+1908)
- Le corps incorrompu de Marie-Louise Nerbolliers, la visionnaire de Diémoz (+ 1910)
- Saint Alexis d’Ugine, la simplicité en Christ (+1934)
- La renommée inattendue de la discrète fermière Victoire Brielle (+1847)
- Sainte Marie-Léonie Paradis, à la suite du Christ (+1912)
- La grande exhumation de saint Charbel (1950)
- Bilocations
- Les vrais miracles de saint Nicolas (+343)
- Maria d’Agreda, le mystère de la Dame en bleu (1629)
- Sainte Agnès de Langeac convertit Monsieur Olier (1633)
- Une bilocation de saint Jean Bosco (1878)
- Padre Pio, en même temps ici et ailleurs (1941)
- Maria Teresa Carloni, mystique au service des chrétiens persécutés (+1973)
- Les âmes du purgatoire se manifestent à « Mamma Natuzza » (+2009)
- Mère Yvonne Aimée de Jésus
- Inédies
- Lévitations
- Saint Philippe Néri, un cœur dilaté par le feu de l’Esprit Saint (+1595)
- Rosanna Battista, brûlante de l'amour du Christ (+1663)
- Saint Joseph de Copertino, le « moine volant » (+1663)
- Les envolées mystiques de Thomas de Cori (+1729)
- Saint Nicolas Planas : la vie pleine de prodiges d’un homme simple (+1932)
- Edvige Carboni, la mystique de Pozzomaggiore (+1952)
- Lacrimations et images miraculeuses
- La dévotion à la Sainte Face
- Notre-Dame du Perpétuel Secours (XIIIe siècle)
- Le crucifix deux fois miraculeux de l’église Saint-Marcel (1519)
- La Tilma de Guadalupe (1531)
- Symbole national russe, Notre Dame de Kazan multiplie les miracles (1579)
- Catherine Labouré et la médaille miraculeuse (1830)
- Le crucifix de Limpias donne à voir l’agonie de Jésus (1919)
- L’image de la Sainte Face du Christ saigne par trois fois à Airola (1947)
- Les larmes de Marie coulent à Syracuse (1953)
- Teresa Musco, le salut par la Croix (+1976)
- Les exsudations d’huile de Myrna et de l’Icône de Soufanieh (1982)
- Le mystérieux visage de Sierck-les-Bains (1985)
- L’icône de Seidnaya exhale un merveilleux parfum (1988)
- Notre-Dame pleure dans les mains de l’évêque (1995)
- Stigmates
- Les stigmates de saint François, blessures d’amour (1224)
- Bienheureuse Christine de Stommeln, épouse mystique de Jésus Christ (1257)
- Jésus crucifié dans le cœur de sainte Claire de Montefalco (+1308)
- Tout un couvent tiré vers le Ciel avec la vénérable Lukarde d’Oberweimar (+1309)
- Marie Lopez de Rivas reçoit la couronne d’épines (+1640)
- Florida Cevoli, la croix au cœur (+1767)
- Gemma Galgani participe à la Passion du Christ (1899)
- La bienheureuse Maria Grazia Tarallo, stigmatisée et mystique extraordinaire (+ 1912)
- Saint Padre Pio, « crucifié d’amour » (1918)
- Hélène Aiello, une « âme eucharistique » (+1961)
- Un triduum au côté de Jésus souffrant (1987)
- Un Jeudi saint à Soufanieh (2004)
- Miracles eucharistiques
- Jésus se laisse voir dans l’eucharistie à Lanciano (750)
- La dernière communion de saint Bonaventure (1274)
- Une hostie vient à elle (1333)
- L’hostie incombustible de Morrovalle (1560)
- Les hosties de Faverney miraculeusement sauvées du feu (1608)
- Les hosties volées de Sienne : « Il y a la Présence » (1730)
- Patierno, où les hosties ont été révélées par des lumières inexplicables (1772)
- Jésus se penche hors de l’ostensoir et bénit les priants (1822)
- L’Enfant Jésus de Prague dans une hostie (1898)
- Le visage de Jésus apparaît sur l’hostie dans l’ostensoir (1902)
- Un tsunami recule devant le Saint Sacrement (1906)
- À Buenos Aires, le muscle cardiaque de Jésus sous le microscope (1996)
- Confirmation à Tixtla de la réelle présence de Jésus dans l’Eucharistie (2006)
- Le miracle eucharistique de Sokolka (2008)
- Nouveau signe de la Présence réelle de Jésus dans l’Eucharistie à Legnica (2013)
- Reliques
- Le voile de Véronique, dit voile de Manoppello
- Le Linceul de Turin a été pendant des siècles la seule image en négatif au monde
- L’image du Linceul de Turin ne peut s’expliquer que par la Passion et la Résurrection de Jésus
- L'exceptionnelle histoire de la Tunique d'Argenteuil (30)
- Saint Louis et les attributs de la Passion (+1270)
- Les reliques de trois Rois mages à Cologne (1164)
- La procession du reliquaire de saint Ange à Licata (+1220)
- Les puissantes reliques de la mystérieuse sainte Philomène (1802)
- Le sauvetage miraculeux du Linceul de Turin (1997)
- Étude comparative des sangs des reliques du Christ
- Des juifs découvrent le Messie
- Saint Paul
- David Paul Drach
- François-Xavier Samson Libermann, israélite converti à la foi en Jésus-Christ (1824)
- Destiné à être rabbin, François Jacob Libermann devient prêtre (1826)
- Théodore Ratisbonne a trouvé « la paix, la lumière et le bonheur » (1827)
- Le rendez-vous mystique d’Alphonse Ratisbonne (1842)
- Eugenio Zolli
- Max Jacob : conversion inattendue d’un artiste libertin (1909)
- Edith Stein « unie au Christ, telle une catholique, et à son peuple telle une juive » (1921)
- Un juif découvre le Messie à la suite de la guérison miraculeuse de sa mère : Patrick Elcabache (1958)
- Olivier : de Pessah à la Pâque chrétienne (2000)
- Aron Jean-Marie Lustiger, un choix de Dieu (+2007)
- Roy Schoeman
- Conversions de musulmans
- Des conversions au Christ massives en terre d’islam (XXe et XXIe siècle)
- Nicolas Nazzour (Soufanieh, après 1981)
- Joseph Fadelle témoigne de sa conversation et des persécutions (1987)
- Afshin demande à Jésus de se révéler à lui (1990)
- Il a rencontré Jésus en cherchant Muhammad (1990)
- Le chemin de Selma vers le baptême (1996)
- Soumia, sauvée par Jésus en entendant les cantiques de Noël (2003)
- Comment le Christ s’est révélé dans la vie d’Aïsha (2004)
- Amir choisit le Christ, même au risque de dormir dans la rue (2004)
- Souad Brahimi, amenée à Jésus par Marie (2012)
- Imène, sauvée des démons par Jésus-Christ (2016)
- La « course-poursuite » de Khadija avec Dieu (2023)
- Conversions de bouddhistes
- Conversions d'athées
- La conversion inespérée d’un bourreau de la Terreur (1830)
- La Vierge Marie sauve Bartolo Longo des griffes de Satan (1877)
- Saint Charles de Foucauld (1886)
- La conversion de Paul Claudel : un grand poète bouleversé pour la vie (1886)
- De l’agnosticisme à l’abbaye de la Trappe de Chimay (1909)
- Alessandro Serenelli, l’assassin sauvé par sa victime (1909)
- Madeleine Delbrêl, éblouie par Dieu (1924)
- C.S. Lewis, converti malgré lui (1931)
- Le jour où André Frossard a rencontré le Christ à Paris (1935)
- Une enfant obtient la conversion du président franc-maçon espagnol (1940)
- La rédemption de Jacques Fesch (1955)
- Enquêtant sur la résurrection du Christ, un journaliste athée se convertit (1981)
- Gunman, du crime au Christ (1983)
- De la mort à la vie : le cheminement du docteur Nathanson (1996)
- Une vision de l'enfer sauve John Pridmore (XXe s)
- Un rappeur de MC Solaar converti par la Passion du Christ (XXe s)
- Le père Sébastien Brière, converti à Medjugorje (2003)
- Carl découvre le brasier d'amour du Christ (2009)
- Franca Sozzani, la « papesse de la mode » qui voulait rencontrer le pape (2016)
- Nelly Gillant, du monde des morts à la foi catholique (2018)
- Au Saint-Sépulcre, le Christ se révèle à Éric-Emmanuel Schmitt, qui écrit pour le raconter (2022)
- Témoignages de rencontres avec le Christ
- Les expériences de mort imminente (EMI) confirment la doctrine sur les fins dernières
- L’EMI de sainte Christine l’Admirable, source de conversion au Christ (1170)
- Jésus parle à Alphonse de Liguori qui, en retour, promet d’entrer dans les ordres (1723)
- Amazing Grace : sauvé du naufrage, et de son péché (+1807)
- L’illumination spirituelle de Louise de Marillac (1623)
- Bienheureuse Dina Bélanger : aimer et laisser faire Jésus et Marie (+1929)
- Simone Weil rencontre le Christ (1938)
- Gabrielle Bossis, « Lui et moi » (+1950)
- La rencontre du Christ et de Jérôme Lejeune (1967)
- La conversion d'André Levet en prison (1969)
- Voyage entre paradis et enfer, une « expérience de mort imminente » (1971)
- Déclaré mort, Ian McCormack rencontre Jésus (1982)
- Le message du Christ à Myrna Nazzour (1984)
- Alice Lenczewska : dialogues avec Jésus (1985)
- Vassula et La Vraie Vie en Dieu (1985)
- Nahed Mahmoud Metwalli, de persécutrice à persécutée (1987)
- Le surnaturel se déploie dans la vie d’Alan Ames (1993)
- Tête-à-tête avec Jésus (1994)
- Le verset de la Bible qui a converti Élie (2000)
- Johann accepte Jésus dans sa vie (2004)
- Expérience mystique sur le chemin de Compostelle (2008)
- Becket Cook rencontre le Christ et change de vie (2009)
- Chantal, invitée à la cour céleste (2017)
- Histoires providentielles
- L’intuition surhumaine de saint Pacôme le Grand (+346)
- Saint Martin est sauvé du feu par la prière (386)
- Ambroise de Milan retrouve les corps des martyrs Gervais et Protais (386)
- Dieu promet en songe à Monique la conversion de son fils (+387)
- Les prédictions et protections de Germain d’Auxerre pour sainte Geneviève (446)
- Apt : les reliques de sainte Anne retrouvées par miracle (792)
- La couronne de saint Étienne de Hongrie (997)
- Saint Géraud et le miracle des fruits à Braga (+1109)
- Il doute de la Providence : Dieu lui envoie sept étoiles pour éclairer sa route (1132)
- La réconciliation surnaturelle du duc d’Aquitaine (1134)
- Dieu charge le petit Bénézet de bâtir un grand pont (1177)
- Zita et le miracle du manteau (XIIIe)
- La Guadalupe espagnole (1326)
- Jeanne d’Arc, la plus belle histoire du monde (+1431)
- Jean de Capistran sauve l’Église et l’Europe (1456)
- Une musique céleste réconforte Elisabetta Picenardi sur son lit de mort (+1468)
- Et une grande lumière ouvrit la porte de son cachot… (1520)
- Le miracle de la transmission de la foi dans l’Église cachée japonaise (1587-1853)
- Jeanne de Chantal et François de Sales : une rencontre préparée par Dieu (1604)
- L’étrange aventure d’Yves Nicolazic (1623)
- Julien Maunoir apprend miraculeusement le breton (1626)
- Pierre de Keriolet : avec Marie, nul ne se perd (1636)
- La prière de sœur Marie des Anges sauve deux fois Turin (1696)
- La conversion autonome de la Corée (XVIIIe)
- Le chapelet et l’officier de la Grande Armée (1808)
- André Bobola prédit la renaissance de la Pologne (1819)
- Vincent de Paul révèle sa vocation à Catherine Labouré (1824)
- Le poème prophétique qui annonçait Jean-Paul II (1840)
- Pierre-Julien Eymard prie et Marie garde le collège (1851)
- Grigio, l’étrange chien de Don Bosco (1854)
- Les flammes purificatrices de Marie-Thérèse de Soubiran (1861)
- Thérèse de Lisieux sauve de la ruine un carmel italien (1910)
- Thérèse de Lisieux, protectrice de ceux qui combattent (1914-1918)
- Une image de la Vierge Marie à l’épreuve des bombes (1921)
- Perdue pendant plus d’un siècle, une icône russe réapparaît (1930)
- Du chemin des vaches à la communauté du Chemin Neuf (1940)
- Notre Dame de la Clarté sauve sa chapelle bretonne (1944)
- Au milieu des ruines, la cellule de Léopold Mandic est intacte (1944)
- En 1947, une croisade du rosaire libère l’Autriche des Soviétiques (1946-1955)
- La découverte du tombeau de saint Pierre à Rome (1949)
- Il était censé mourir de froid dans les geôles soviétiques (1972)
- Un agent secret protégé par Dieu (1975)
- La lave s’arrête aux portes de l’église (1977)
- Une main protectrice sauve Jean-Paul II avec des répercussions providentielles (1981)
- Marie qui défait les nœuds : le cadeau du pape François au monde (1986)
- La découverte de Notre-Dame de France par Edmond Fricoteaux (1988)
- Un évêque vietnamien tiré de prison par Marie (1988)
- La chute du communisme (1989)
- Jésus retarde le décès de Lizzie (1990)
- Les miracles de sainte Julienne (1994)
- Frappée par la foudre, Gloria se tient aux portes de l’enfer (1995)
- L’huile merveilleuse coule à l’abbaye de Bonneval (1996)
- Le lancement des « Vierges pèlerines » dans le monde a été permis par la Providence de Dieu (1996)
- La découverte providentielle des bâtiments du Centre international Marie de Nazareth (2000)
- La dépouille de sainte Kyranna miraculeusement retrouvée 250 ans après son martyre (2011)
- Un couvent miraculeusement protégé de tous les maux (2011-2020)
- Retour de l’anneau de Jeanne d’Arc en France : une affaire providentielle (2016)
- La conversion de Fabrice Amedeo, au beau milieu de l’océan (2025)
- Jésus
- Qui sommes-nous ?
- Chaîne Youtube
- Faire un don
- S'abonner au magazine
< Toutes les raisons sont ici !

TOUTES LES RAISONS DE CROIRE
- Jésus
- Il y a de multiples preuves de la Résurrection du Christ
- Le Christ a donné toutes les preuves divines qui convenaient (cf. SCLG n°6)
- La sublimité de la Parole du Christ
- Le trilemme de Lewis : une preuve de la divinité de Jésus
- L'autorité divine du Christ, dont le seul nom chasse les démons
- Dieu sauve : la puissance du saint nom de Jésus
- Jésus, l'homme qui parlait et agissait comme l'égal de Dieu
- La vérité de Jésus transparaît même dans le Coran
- La grandeur sublime de la Passion du Christ
- Le seul homme dont on témoigne au prix de la vie qu'il est ressuscité des morts
- Jésus est venu au meilleur moment pour façonner l’histoire de l’humanité
- Les sources rabbiniques rendent témoignage aux miracles de Jésus
- Marie
- L'Eglise
- La propagation miraculeuse du Christianisme
- La conversion de l’Empire romain au christianisme (392)
- L'Eglise catholique et son magistère existent depuis près de 2000 ans
- Le Magistère infaillible de l'Eglise
- Le concept de Révélation suppose le concept de Magistère
- Le trésor de la doctrine sociale de l'Eglise
- Les innombrables « sceaux de Dieu » recueillis par le Dicastère pour la cause des saints
- Humane Vitae, un argument frappant en faveur du catholicisme (1968)
- La Bible
- La prophétie du Temple détruit est stable, malgré Julien l’Apostat
- Les auteurs des Évangiles sont des témoins oculaires ou de proches associés
- L’onomastique est en faveur de la fiabilité historique des Évangiles
- Le Nouveau Testament n’a pas été corrompu
- Le Nouveau Testament est le manuscrit le mieux attesté de l’Antiquité
- Les Évangiles ont été écrits trop tôt pour être des légendes
- Le Nouveau Testament est fiable, c’est l’archéologie qui le dit
- Le critère d’embarras prouve que les Évangiles ne peuvent pas être un mensonge
- Le critère de dissimilarité renforce la fiabilité des Évangiles
- 84 détails du livre des Actes des apôtres sont confirmés par l’histoire et l’archéologie
- D'extraordinaires prophéties annonçaient la venue du Messie
- Le temps de la venue du Messie a aussi été précisément prophétisé
- La peinture ultraréaliste des tortures du Messie par le prophète Isaïe
- Le prophète Daniel a annoncé un « fils d’homme » qui est le portrait du Christ
- Rapidité et fiabilité de la genèse des Evangiles
- Les Apôtres
- Saint Pierre, chef des apôtres (+64)
- Saint André, le premier des apôtres appelés par Jésus (+45)
- Saint Jacques le Majeur, premier apôtre martyr (+41)
- Saint Jean l’évangéliste, apôtre et « Théologien » : un géant trop méconnu (+100)
- Saint Philippe (+85)
- Saint Barthélémy (+47)
- Saint Thomas, du doute à la Chine (+72)
- Saint Matthieu, apôtre, évangéliste et martyr (+61)
- Jacques le Juste, « frère » du Christ, apôtre et martyr (+62)
- L’apôtre saint Jude, témoin véridique de la vie de Jésus (+65)
- Saint Simon le Zélote (+60)
- Saint Matthias devenu apôtre après la mort de Jésus (+63)
- Les martyrs
- Saint Jean-Baptiste (+29)
- Saint Étienne, premier des martyrs (+31)
- Rome brûle, l’Évangile perdure (64)
- Polycarpe, évêque de Smyrne, disciple de Jean et martyr (+155)
- Justin de Naplouse, apologète et martyr (+165)
- Sainte Blandine et les Martyrs de Lyon, la force de la foi (+177)
- Apollonius aime la vie, mais la vraie, la vie éternelle (+185)
- Sainte Martine : « Celle-là, Dieu sait son nom. » (+IIIe s)
- Sainte Cécile (+230)
- Saint Saturnin, mis à mort en étant traîné par un taureau (+250)
- Sainte Agathe sauve la ville de Catane de la lave (+251)
- Tarcisius, martyr de l’Eucharistie (+257)
- Alban, de la conversion au martyre (+288)
- Dieu protège la virginité d’Agnès qui s’est consacrée à lui (+305)
- Sainte Lucie de Syracuse, vierge et martyre pour Jésus-Christ (+304)
- Afra, de la prostitution au martyre (+305)
- Sainte Marguerite d’Antioche (+305) apparaît à Jeanne d’Arc pour la préparer à sa mission
- Sainte Julienne de Nicomédie (IVème siècle)
- Ils préfèrent mourir de froid plutôt que de renier le Christ : les quarante martyrs de Sébaste (+320)
- Saint Boniface sème la parole en Germanie (+754)
- La révolte pacifique des catholiques de Cordoue (850)
- Solange, martyre de la pureté (+878)
- Dieu fait d’un lâche un héros de la foi (+1460)
- Thomas More, « bon serviteur du roi, et de Dieu en premier » (+1535)
- Thomas Plumtree meurt ici-bas pour ne pas mourir à la vie divine (+1570)
- Le martyre de Paul Miki et de ses compagnons (+1597)
- Anne Line, pendue pour avoir caché des prêtres (+1601)
- Oliver Plunkett, « coupable de promouvoir la foi catholique » (+1681)
- « C’est lui que j’aime et je suis prête à mourir pour lui » : la néo-martyre Kyranna (+1751)
- Filles de la Charité, elles prédisent la fin des persécutions (+1794)
- Les martyrs d’Angers et d’Avrillé (+1794)
- La dernière messe de Noël Pinot (+1794)
- Les seize Carmélites martyres (+1794)
- À Orange, le Christ accompagne les religieuses jusqu’à l’échafaud (+1794)
- Le père Dung Lac et ses 116 compagnons martyrs au Vietnam (XVIIe - XIXe)
- Angélis de Chio, la folie du martyre (+1813)
- Il brave les supplices pour expier son apostasie (+1818)
- Jésus rend la foi à Jean-Gabriel Perboyre (+1838)
- Blaise Marmoiton, l'épopée d'un missionnaire au bout du monde (+1847)
- Double peine pour le père Chapdelaine (+1856)
- Dominique Cam ne piétine pas la croix, mais l’embrasse (+1859)
- Siméon-François Berneux, le prêtre sarthois devenu évêque et martyr en Corée (+1866)
- Les martyrs d’Ouganda ou l’éternelle répétition des persécutions (1885)
- Miguel Pro, icône du Christ (+1927)
- Mort à 14 ans pour le Christ Roi, José Luis Sanchez del Rio (+1928)
- Le témoignage des sept martyrs de Songkhon (1940)
- Saint Maximilien Kolbe, le chevalier de l’Immaculée (+1941)
- Franz Jägerstätter : il ne pouvait pas être catholique et nazi (+1943)
- Anna Kolesarova, « hostie de la sainte chasteté » (+1944)
- Mgr Janos Scheffler, le pardon aux bourreaux (+1952)
- Stepinac dit non à Tito et reste fidèle à l’Église de Jésus-Christ (+1960)
- La vie offerte des moines de Tibhirine (+1996)
- « Frères à la vie, frères à la mort » (+1997)
- Les moines
- Les Pères du désert (IIIe siècle)
- Saint Antoine du désert, le « père des moines » (+356)
- Saint Benoît, patriarche des moines d’Occident (+550)
- Le Mont Athos (Xème siècle)
- Un abbé en prière pour son siècle : Mayeul de Cluny (+994)
- Saint Bruno le Chartreux, miracle de la vie cachée (+1101)
- Le bienheureux Ange-Augustin Mazzinghi, carme couronné de fleurs (+1438)
- Antonin de Florence : moine, prophète et archevêque (+1459)
- Frère Corradino donne tout et mendie pour donner davantage (+1468)
- Capucin thaumaturge, bienheureux Marc d’Aviano (+1699)
- Les prophéties réalisées du moine Abel pour la Russie (+1841)
- Nimatullah Al-Hardini, empli de la grâce de Dieu (+1858)
- Les 29 349 miracles de saint Charbel Maklouf (+1898)
- La prière perpétuelle de Silouane de l’Athos (+1938)
- Saint Padre Pio : les merveilles de Dieu à travers un humble frère qui prie (+1968)
- La mort étonnante du père Emmanuel de Floris (+1992)
- Les prophéties du père Païssios, du mont Athos (+1994)
- L’extraordinaire frère Toufik (+2021)
- Les saints
- La « légende » des saints n’est pas un mythe
- Sainte Anne et saint Joachim, parents de la Vierge Marie (-19)
- Saint Jean-Baptiste, témoin du Christ annoncé par les prophètes (+28)
- Saint Nazaire, apôtre et martyre (+68 ou 70)
- Ignace d’Antioche : successeur des apôtres et témoin de l’Évangile (+117)
- Saint Grégoire le Thaumaturge (+270)
- Gatien, apôtre de la Touraine (IIIe s)
- Saint Martin de Tours, père de la France chrétienne (+397)
- La grande conversion de Fabiola (+399)
- Mélanie la Jeune : par le chas d’une aiguille (+439)
- Syméon monte sur une colonne pour demeurer seul avec le Christ (+459)
- Sainte Geneviève, patronne de Paris (+502)
- Saint Avit de Vienne affirme la divinité de Jésus (+518)
- Saint Remi, l’évêque qui baptisa le roi des Francs (+533)
- Hilaire de Mende, un saint évêque thaumaturge (+540)
- Saint Augustin de Cantorbéry apporte la bonne nouvelle sur la terre des Angles (+604)
- Saint Loup, l’évêque qui fit rebrousser chemin à Attila (+623)
- Saint Ildefonse de Tolède, défenseur de la Vierge Marie (+667)
- Née aveugle, sainte Odile retrouve la vue lors de son baptême (+720)
- Saint Rainer de Pise : la conversion miraculeuse d’un riche négociant (+1160)
- Saint Dominique de Guzman, athlète de la foi (+1221)
- Saint François, le pauvre d’Assise (+1226)
- Saint Antoine de Padoue, le « saint que tout le monde aime » (+1231)
- Sainte Rose de Viterbe : comment la prière change le monde (+1252)
- Saint Simon Stock reçoit le scapulaire du Mont Carmel (+1265)
- L’étrange barque de saint Basile de Riazan (+1295)
- L’absolue confiance en Dieu de sainte Agnès de Montepulciano (+1317)
- Sainte Élisabeth du Portugal, une rose en royauté (+1336)
- L’extraordinaire conversion de Micheline de Pesaro (+1356)
- Le mariage virginal de bienheureuse Delphine de Sabran (+1360)
- Saint Pierre Thomas : une confiance en la Vierge Marie à toute épreuve (+1366)
- Jeanne-Marie de Maillé traverse les humiliations et la misère accompagnée par la Vierge Marie (+1414)
- Saint Vincent Ferrier, mirificus praedicator (+1419)
- Les prodigieux sermons de Bernardin de Sienne (+1444)
- Sainte Rita de Cascia, celle qui espère contre toute espérance (+1457)
- Jacques de la Marche transmet la foi catholique à travers l’Europe (+1476)
- Dieu parle par la bouche de la bienheureuse Madeleine de Panattieri (+1503)
- Sainte Catherine de Gênes, ou le feu de l’amour de Dieu (+1510)
- Saint Antoine-Marie Zaccaria, médecin des corps et des âmes (+ 1539)
- Saint Ignace de Loyola : à la plus grande gloire de Dieu (+1556)
- Pierre d’Alcantara, à qui Dieu ne refuse rien (+1562)
- Saint Pascal Baylon, la gloire mondiale d’un humble berger (+1592)
- Saint Bernardin Realino répond à l’appel divin (+1616)
- Alphonse Rodriguez, le saint portier jésuite (+1617)
- Martin de Porrès revient hâter sa béatification (+1639)
- Virginia Centurione Bracelli : quand toutes les difficultés s’aplanissent (+1651)
- Sainte Marie de l’Incarnation, « la sainte Thérèse du Nouveau Monde » (+1672)
- Jean Eudes, époux du Cœur Immaculé de Marie (+1680)
- Kateri Tekakwitha, une sainte chez les Mohawks (+1680)
- Claude La Colombière prédit son emprisonnement (+1682)
- Saint François de Laval : père de l’Église canadienne (+1708)
- François de Girolamo lit les cœurs (+1716)
- Rosa Venerini ou la parfaite volonté de Dieu (+1728)
- Le succès étonnant des prédications de saint Ange d’Acri (+1739)
- Le pacte de la comtesse Molé avec la Croix de Jésus-Christ (+1825)
- Jeanne-Antide Thouret : partout où Dieu voudra l’appeler (+1826)
- Lorsque le moine Seraphim contemple le Saint-Esprit (+1833)
- Gaspard del Bufalo, le prêtre qui a dit non à Napoléon (+1837)
- La confiance en Dieu de sainte Marie-Madeleine Postel (+1846)
- Camille de Soyécourt, comblée par Dieu de la vertu de force (+1849)
- Bernadette Soubirous, bergère qui vit la Vierge (1858)
- Saint Jean-Marie Vianney, la gloire mondiale d'un petit curé de campagne (+1859)
- Gabriel de l’Addolorata, le « jardinier de la Sainte Vierge » (+1862)
- Michel Garicoïts lève une armée contre l’Antéchrist (+1863)
- À Grenoble, le « saint abbé Gerin » (+1863)
- Antoine-Marie Claret, un tisserand devenu ambassadeur du Christ (+1870)
- Bienheureux Francisco Palau y Quer, un amoureux de l’Église (+1872)
- Thérèse Couderc remet tout entre les mains de Marie (+1885)
- Newman cherche la véritable Église du Christ (+1889)
- Les saints époux Louis et Zélie Martin (+1894)
- La vie en Jésus Christ de Jean de Cronstadt (+1908)
- Celina Chludzinska, une vie entre les mains de Dieu (+1913)
- La maturité surnaturelle de Francisco Marto, « consolateur de Dieu » (+1919)
- Saint André Bessette, serviteur de saint Joseph (+1937)
- Sainte Faustine, apôtre de la divine miséricorde (+1938)
- Mère Marie Skobtsova, une moniale hors du commun (+1945)
- Sainte Joséphine Bakhita, de la souffrance à l’amour (+1947)
- Frère Marcel Van, une « étoile s’est levée en Orient » (+1959)
- Sainte Gianna Beretta Molla donne la vie, au prix de la sienne (+1962)
- Carlo Acutis, faire-valoir de Jésus Hostie (+2006)
- Les docteurs
- Saint Irénée de Lyon, docteur de l’unité (+202)
- Saint Ambroise de Milan, évêque malgré lui (+397)
- Saint Jérôme, traducteur et interprète des Saintes Écritures (+420)
- Saint Augustin (+430)
- L’intelligence d’Isidore de Séville au service de la foi (+636)
- Saint Bernard, abbé de Clairvaux et docteur de l’Église (+1153)
- Saint Thomas d'Aquin (+1274)
- Saint Albert le Grand, les noces de l'intelligence et de la foi (+1280)
- Sainte Catherine de Sienne, épouse du Christ dans la foi (+1380)
- Thérèse d’Avila, piquée par le feu d’amour de Dieu (+1582)
- Pierre Canisius, défenseur de la foi catholique en Allemagne (+1597)
- Saint Robert Bellarmin, défenseur de la foi catholique (+1621)
- Saint François de Sales, docteur de l’Amour divin (+1622)
- Saint Louis-Marie Grignion de Montfort (+1716)
- Saint Alphonse de Liguori, l'œuvre surnaturelle d'un avocat (+1787)
- Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus (+1897)
- Les mystiques
- Sainte Lutgarde et la dévotion au Sacré Cœur (+1246)
- Sainte Gertrude de Helfta, touchée par la grâce divine (+1301)
- Sainte Angèle de Foligno et « dame pauvreté » (+1309)
- Dorothée de Montau, épouse, mystique et sainte (+1394)
- Les révélations reçues par Julienne de Norwich sur l’amour divin (+1416)
- La profonde vie mystique de Catherine Racconigi (+1547)
- Sainte Thérèse d'Avila (+1582)
- Saint Jean de la Croix, poète et psychologue universel (+1591)
- Saint Alphonse d’Orozco est emmené en esprit au Ciel (+1591)
- Sainte Rose de Lima, « un lys parmi les épines » (+1617)
- Bienheureuse Anne de Jésus, carmélite aux dons mystiques (+1621)
- Les visions de Marguerite de Beaune pour la France (1636)
- Les évanouissements du cœur de Maria Angela Astorch (+1665)
- Catherine Daniélou, témoin du Christ en Bretagne (+1667)
- Une fleur au milieu des ruines : Giovanna Maria Bonomo (+1670)
- Mère Maria Villani, épouse mystique de Jésus-Christ (+1670)
- Sainte Marguerite-Marie voit le « Cœur qui a tant aimé les hommes » (+1690)
- Jeanne Le Ber, la recluse de Ville-Marie (+1714)
- Jésus fait de Maria Droste zu Vischering la messagère de son Divin Cœur (+1899)
- Les prédictions de sœur Yvonne-Aimée concernant la Seconde Guerre mondiale (1922)
- Sœur Josefa Menendez, apôtre de la miséricorde divine (+1923)
- Édith Royer et le Sacré-Cœur de Montmartre (+1924)
- La vie mystique de Conchita, épouse et mère (+1937)
- Rozalia Celak, une mystique à la mission très spéciale (+1944)
- Sœur Consolata, en dialogue constant avec Jésus (+1946)
- Don Dolindo fait peindre le visage du Christ, tel qu’il l’a vu (+1970)
- Les extases de Myrna Nazzour (1983)
- Rolande Lefevre (+2000)
- Caterina Bartolotta, mystique d’aujourd’hui (XXIè s)
- Les visionnaires
- Sainte Perpétue délivre son frère du purgatoire (203)
- Anne-Catherine Emmerich
- Saint Malachie d’Armagh voit par trois fois l’âme de sa sœur morte (+1148)
- Les prophéties précises et exactes de la Vierge Marie à mère Mariana de Jesus Torres au sujet de l’Équateur (1599)
- Marie d’Agreda retranscrit la vie de la Vierge Marie (+1665)
- La découverte de la maison de la Vierge Marie à Éphèse (1891)
- Sœur Benigna Consolata, la « petite secrétaire de l’amour miséricordieux » (+1916)
- Quand les visions de Maria Valtorta coïncident avec les observations de l’Institut météorologique d’Israël (1943)
- Berthe Petit et ses prophéties relatives aux deux guerres mondiales (+1943)
- Maria Valtorta ne voit qu’une seule des pyramides de Gizeh… et à raison ! (1944)
- Le village de saint Pierre localisé par vision avant sa découverte archéologique (1945)
- Les 700 extraordinaires visions de l’Évangile reçues par Maria Valtorta (+1961)
- L’étonnante exactitude géologique des écrits de Maria Valtorta (+1961)
- Les observations astronomiques des écrits de Maria Valtorta confirmées (+1961)
- Découverte anticipée par vision mystique d’une maison princière à Jérusalem (+1961)
- Les tours de Jezreel dans les écrits de Maria Valtorta (+1961)
- Mariette Kerbage, la voyante d’Alep (1982)
- Les prophéties révélées à sœur Marie-Nathalie Kovacsics (+1992)
- Les 20 000 icônes de Mariette Kerbage (2002)
- Les papes
- L’Esprit Saint désigne Fabien comme nouveau pape (236)
- Saint Jean Ier, pape et martyr (+526)
- Saint Silvère, un pape contre les hérétiques (+537)
- Saint Grégoire le Grand, modèle des papes (+604)
- Saint Célestin V : à 84 ans, rien ne le prédestinait à devenir Pape (+1296)
- Saint Pie X (+1914)
- Le bon pape, saint Jean XXIII (+1963)
- Saint Jean-Paul II (+2006)
- Les grands témoins de la foi
- Domitille : princesse romaine chrétienne du Ier siècle (+1er s)
- La conversion de saint Augustin : « Combien de temps remettrai-je à demain ? » (386)
- François de Sienne confie tout à la Vierge Marie et lui livre son cœur (+1328)
- Tommaso de Vio, dit Cajétan, une vie au service de la vérité (+1534)
- Madame Acarie ou le « livre vivant de l’amour de Dieu » (+1618)
- Pascal et la révélation des prophètes (+1662)
- Madame Élisabeth, ou le parfum des vertus (+1794)
- Les époux Beltrame : tout entre les mains de Dieu (1913)
- Jacintha, 10 ans, offre ses souffrances pour sauver des âmes de l’enfer (+1920)
- Anne de Guigné, la petite fille qui parlait à Jésus (+1922)
- Le père Jean-Édouard Lamy, un « second curé d’Ars » (+1931)
- Monseigneur von Galen, « le Lion de Münster » (+1946)
- Ce qui a fait persévérer Marie Noël dans la foi (+1967)
- La mission de Maria Gargani : faire aimer le cœur de Jésus (+1973)
- Claire de Castelbajac transfigurée par la joie de Dieu (+1975)
- Le vagabond de Dieu, John Bradburne (+1979)
- L’offrande de Chiara Luce au Christ (+1990)
- La mission de Lucie Dos Santos après Fatima (+2005)
- l'Abbé Georges Lemaître
- La civilisation chrétienne
- La profondeur de la spiritualité chrétienne
- Henri Bergson : « Le mysticisme complet est celui des chrétiens »
- Cohérence et force de la vie mystique chez Jean de la Croix
- Le christianisme offre une clé essentielle pour comprendre la nature humaine
- Le dogme de la Trinité : une vérité de mieux en mieux comprise
- L’incohérence des critiques contre le christianisme
- La loi de Dieu n’est pas arbitraire
- L’Esprit Saint se manifeste de nos jours comme en une « nouvelle Pentecôte »
- La foi chrétienne explique la diversité des religions
- L'imitation de Jésus-Christ
- Les images de la Sainte Trinité selon saint Augustin
- Les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, pour se tourner vers le Christ
- Le chemin de Saint Jacques de Compostelle
- Les miracles des pardons impossibles
- Le christianisme fut un moteur essentiel de l’abolition de l’esclavage
- Le cardinal Pierre de Bérulle sur le mystère de l’Incarnation (+1629)
- La théologie du corps de saint Jean-Paul II
- Les interventions du Christ dans l'Histoire
- Les apparitions et interventions mariales
- Notre Dame du Pilier vient redonner courage à l’apôtre Jacques à Saragosse (40)
- Le Puy-en-Velay (431)
- Une source à l'origine d'une multitude de miracles à Constantinople (457)
- Apparition, prophétie et guérisons de la Vierge Marie dans le Nord de la France (600)
- Plus de mille ans que Marie agit pour les hommes à Foggia (1001)
- Notre Dame des Vertus sauve la ville de Rennes (1357)
- Czestochowa, l’âme de la Pologne (1384)
- Marie fait arrêter l’épidémie de peste au mont Berico (1426)
- Notre Dame des miracles guérit un paralytique à Saronno (1460)
- Notre-Dame de Treize-Pierres, en Aveyron (1509)
- Cotignac, premières apparitions modernes de l'histoire (1519)
- La Vierge Marie porte la Bonne Nouvelle aux Indiens du Mexique (1531)
- Savone : la naissance d’un sanctuaire (1536)
- La Vierge Marie délivre les chrétiens de la cité de Cuzco au Pérou (1536)
- Notre Dame de l’Agenouillée (1550)
- La victoire de Lépante et la fête de Notre-Dame du Rosaire (1571)
- Les apparitions au frère Fiacre (1637)
- Le « vœu des échevins », ou la dévotion mariale des Lyonnais (1643)
- Notre Dame de Nazareth à Plancoët (1644)
- La Madone de Laghet (1652)
- Les apparitions de saint Joseph au Bessillon (1661)
- Les confidences du Ciel à la bergère du Laus (1664-1718)
- Notre Dame des Neiges au secours des soldats catholiques (1716)
- Zeitoun, un miracle de deux années (1968-1970)
- Le Saint Nom de Marie et la victoire décisive de Vienne (1683)
- Le ciel touche la terre en Colombie : Las Lajas (1754)
- Le « M » que Marie a tracé sur la France sera rappelé le 26 mai prochain (XIXe)
- Les 37 000 prières exaucées, gravées dans le marbre d’une basilique parisienne (XIXe)
- La Vierge apparaît et prophétise en Ukraine depuis le XIXe siècle (1806)
- La nuit extraordinaire de sœur Labouré (1830)
- « Consacre ta paroisse au cœur immaculée de Marie » (1836)
- A la Salette, Marie pleure près des bergers (1846)
- Les apparitions de Lourdes, d’authentiques expériences surnaturelles (1858)
- La Vierge Marie dans le Wisconsin : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » (1859)
- Pontmain (1871)
- Les quinze apparitions de Notre Dame à Pellevoisin (1876)
- Les apparitions de Gietrzwald, un secours extraordinaire en Pologne (1877)
- L'apparition silencieuse de Knock Mhuire en Irlande (1879)
- Cuapa : la Vierge est en Équateur (1980)
- Marie « Mère abandonnée » apparaît dans un quartier populaire de Lyon (1882)
- Les trente-trois apparitions de la Vierge Marie à Beauraing (1932)
- La « Vierge des pauvres » apparaît à huit reprises à Banneux (1933)
- Face à la Gestapo, elles soutiennent qu’elles ont vu la Vierge Marie (1937)
- La Rosa Mystica de Montichiari (1947)
- Marie répond au vœu des Polonais (1956)
- Ils sont des centaines de milliers à avoir vu la Vierge à Zeitoun en Égypte (1968)
- « Une Belle Dame » vient au secours de la France à l'Ile Bouchard (1947)
- Maria Esperanza et Notre-Dame Réconciliatrice des Peuples de Bétania (1976)
- Luz Amparo et les apparitions de l’Escorial en Espagne (1981)
- Les extraordinaires apparitions de Medjugorje et leur impact mondial (1981)
- La Vierge Marie prophétise les massacres au Rwanda (1981)
- Apparitions et message de la Vierge Marie à Myrna (1982)
- San Nicolas : lorsque Marie visite l’Argentine (1983)
- La Vierge Marie guérit un adolescent, avant de lui apparaître à Belpasso (1986)
- Seuca : l’appel de la « Reine de lumière » en Roumanie (1995)
- Les anges et leurs manifestations
- Les anges gardiens « pour te garder en toutes tes voies »
- Le Mont Gargano
- Le Mont Saint-Michel, ou comment le ciel veille sur la France
- La révélation de l’Axion estin par l’archange Gabriel (982)
- Des anges donnent une ceinture surnaturelle au chaste Thomas d’Aquin (1243)
- Françoise Romaine, le jeu du Ciel et de l’enfer (+1440)
- Les anges finissent la statue de Notre Dame du Bon Succès (1610)
- L’ange qui fait évader Mère Yvonne-Aimée de Malestroit (1943)
- Le sauvetage angélique des accidentés de l’autoroute 6 (2008)
- Les exorcismes au nom du Christ
- Une vague de charité unique au monde
- D'innombrables œuvres de charité
- D'innombrables œuvres d'éducation
- Saint Martin de Tours
- Saint Pierre Nolasque, apôtre de la liberté chrétienne (+1245)
- Rita de Cascia pardonne à l’assassin de son mari (1404)
- Sainte Angèle Mérici : pour servir, non être servie (+1540)
- Saint Jean de Dieu, ou Jésus au service des malades (+1550)
- Saint Camille de Lellis, réformateur des soins hospitaliers (vers 1560)
- Bienheureuse Alix Le Clerc, encouragée par Marie à créer des écoles (+1622)
- Saint Vincent de Paul, apôtre de la charité (+1660)
- Marguerite Bourgeoys, première enseignante de Montréal (+1700)
- Takashi Nagai
- Frédéric Ozanam, inventeur de la doctrine sociale de l’Église (+1853)
- Sainte Joaquina de Vedruna fonde les Carmélites de la Charité (+1854)
- Madame de l’Espérance (+1868)
- Damien de Molokai, missionnaire lépreux (+1889)
- Anne-Marie Adorni au service des prisonnières de Parme (+1893)
- Bienheureuse Josefa Naval Girbés (+1893)
- George Müller adresse ses demandes à Dieu seul (+1898)
- Thérèse-Adélaïde Manetti : une enfance pauvre, un riche héritage (+1910)
- Camille Costa de Beauregard, un père pour les orphelins de Chambéry (+1910)
- Pier Giorgio Frassati, la charité héroïque (+1925)
- Giuseppe Moscati, un saint en blouse blanche (+1927)
- Bienheureuse Irène, « Mère pitié » du Kenya (+1930)
- Mère Marie-Thérèse de Saint-Joseph, « un ange de réconfort et de paix » (+1938)
- Don Luigi Orione, stratège de la charité (+1940)
- Prince Ghika, alias « sœur Vladimir » (+1954)
- Maravillas de Jésus : une charité à l’échelle du monde (+1974)
- Akamasoa : « l’expression de la présence de Dieu au milieu de son peuple pauvre » (1989)
- Sœur Dulce, le « bon ange de Bahia » (+1992)
- Mère Teresa de Calcutta, une foi inébranlable (+1997)
- Heidi Baker : l’amour de Dieu au cœur des ténèbres
- Des miracles étonnants
- Le Linceul de Turin, témoin de la Passion et de la Résurrection du Christ
- Le Saint Feu de Jérusalem
- Dorothée reçoit des fruits et des fleurs du ciel (+304)
- Le miracle toujours recommencé du sang de saint Pantaléon (+305)
- Le miracle de la liquéfaction du sang de saint Janvier (+431)
- Le miracle des ardents (1130)
- Les miracles de saint Antoine de Padoue (+1231)
- Les multiplications surnaturelles de saint Yves pour les pauvres (+1303)
- Les panini benedetti de saint Nicolas de Tolentino (1447)
- Louis XI apprend à chercher l’éternité plutôt que la guérison (1483)
- Saint Pie V et le miracle du crucifix (1565)
- Une fleur inconnue pousse sur la fosse commune (1572)
- Saint Philippe Néri ressuscite un jeune mort (1583)
- La résurrection de Jérôme Genin (1623)
- Saint François de Sales ressuscite une enfant noyée (1623)
- Le bon père Fourier, un curé lorrain mémorable (+1640)
- Le miracle de Calanda : du moignon à la jambe (1640)
- Le rôti inépuisable de Marie-Thérèse de Lamourous (+1836)
- Saint Jean Bosco et la promesse d’outre-tombe (1839)
- Le jour où le Soleil dansa (1917)
- Un navire de guerre sauvé par le Saint Sacrement (1918)
- À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le signe annoncé par la Vierge Marie apparaît dans le ciel (1938)
- Pie XII et le miracle du soleil au Vatican (1950)
- Stanley Villavicencio, Lazare des temps modernes (1993)
- L'escalier de saint Joseph à Santa Fe
- Le sauvetage miraculeux de Charle par Charles (2016)
- Reinhard Bonnke : 89 millions de conversions (+2019)
- Guérisons miraculeuses
- Le toucher des écrouelles : un miracle de guérison pluriséculaire (XIe-XIXe)
- Réginald d’Orléans est guéri in extremis par la Vierge Marie (1218)
- Le miracle de l’épine (1656)
- Pauline Jaricot miraculeusement guérie par sainte Philomène (1835)
- Avec plus de 7500 dossiers de guérisons inexpliquées, Lourdes est unique au monde (1858)
- Confiante, Catherine Latapie plonge son bras dans la flaque boueuse (1858)
- Pierre de Rudder : une guérison spectaculaire par l’intercession de Notre Dame de Lourdes (1875)
- Estelle Faguette est guérie par la « toute miséricordieuse » (1876)
- Mariam, le « petit rien de Jésus » : une sainte de l'Orient à l'Occident (+1878)
- Saint Charbel guérit aux quatre coins du monde (+1898)
- La guérison miraculeuse de Marie Bailly et la conversion d’Alexis Carrel (1902)
- Gemma, guérie afin d’expier les fautes des pêcheurs (+1903)
- Notre Dame de Lourdes intervient loin du sanctuaire (1910)
- La terre du tombeau de sainte Rafqa (+1914)
- La guérison de Sœur Marie-Joséphine Catanea (+1948)
- Les os déformés de Briege sont redressés (1970)
- Électrocuté, le jeune pompier revient à la vie (1980)
- Guérie d’une maladie incurable, Maureen croit finalement aux miracles (1981)
- La guérison extraordinaire d’Alice Benlian en l’église Sainte-Croix de Damas (1983)
- Une fillette s’empoisonne, Edith Stein la sauve (1987)
- Du Ciel, Jeanne Jugan soulage encore les souffrances du prochain (1988)
- Le miracle survenu le jour de la béatification de Juan Diego Cuauhtlatoatzin (1990)
- « Pour que le monde croie, tes plaies s’ouvriront tous les 22 du mois » (1993)
- Un prêtre guéri par sainte Faustine, apôtre de la miséricorde divine (1995)
- La bienheureuse Marguerite Bays sauve une enfant (1998)
- Le miracle qui a conduit frère André sur les autels (1999)
- Guérison miraculeuse grâce à un message du Christ (2001)
- Le pape Jean-Paul Ier au chevet d’une fillette (2001)
- Le grand miracle de Luigi Guanella (2002)
- La repousse de l’intestin de Bruce Van Natta : un miracle irréfutable (2007)
- L’intercession miraculeuse de saint Ludovic Pavoni (2009)
- La chute aux conséquences inattendues d’Annabel Beam (2011)
- Le jour où il est béatifié, Jean-Paul II guérit une mère de famille (2011)
- Il avait « zéro » chance de vivre : la guérison miraculeuse d’un bébé (2015)
- Guérison d’un diacre par l’intercession du bienheureux Francesco Mottola (2010)
- Miracle aux urgences pédiatriques (2010)
- Sortie du coma par l’intercession de Pauline Jaricot (2012)
- Guérison de Shams, petite fille musulmane de Bagdad (2014)
- Manouchak, opérée par saint Charbel (2016)
- Le cancer de Maya, guérie sur le tombeau de saint Charbel (2018)
- L’espérance en Dieu, plus forte que le cancer (2024)
- Père Emiliano Tardif
- Damian Stayne
- Corps conservés des saints
- Mourir en odeur de sainteté
- Le corps de sainte Cécile, retrouvé intact (+230)
- Gildas : toutes les marques de la sainteté (+565)
- Saint Claude, vertueux dans la vie et dans la mort (+699)
- Saint Romuald, ermite et réformateur infatigable (+1027)
- Jean le Bon, l’ermite de Mantoue (+1249)
- Stanislas Kostka brûle d’amour pour Dieu (+1568)
- Sainte Germaine de Pibrac, la petite Cendrillon de Dieu (+1601)
- Bienheureux Antonio Franco, l’évêque défenseur des pauvres (+1626)
- Le repos de saint Dimitri de Rostov, pour les siècles des siècles (+1706)
- Giuseppina Faro, servante de Dieu et des pauvres (+1871)
- Don Gaspare Goggi, une « graine de saint » (+1908)
- Le corps incorrompu de Marie-Louise Nerbolliers, la visionnaire de Diémoz (+ 1910)
- Saint Alexis d’Ugine, la simplicité en Christ (+1934)
- La renommée inattendue de la discrète fermière Victoire Brielle (+1847)
- Sainte Marie-Léonie Paradis, à la suite du Christ (+1912)
- La grande exhumation de saint Charbel (1950)
- Bilocations
- Les vrais miracles de saint Nicolas (+343)
- Maria d’Agreda, le mystère de la Dame en bleu (1629)
- Sainte Agnès de Langeac convertit Monsieur Olier (1633)
- Une bilocation de saint Jean Bosco (1878)
- Padre Pio, en même temps ici et ailleurs (1941)
- Maria Teresa Carloni, mystique au service des chrétiens persécutés (+1973)
- Les âmes du purgatoire se manifestent à « Mamma Natuzza » (+2009)
- Mère Yvonne Aimée de Jésus
- Inédies
- Lévitations
- Saint Philippe Néri, un cœur dilaté par le feu de l’Esprit Saint (+1595)
- Rosanna Battista, brûlante de l'amour du Christ (+1663)
- Saint Joseph de Copertino, le « moine volant » (+1663)
- Les envolées mystiques de Thomas de Cori (+1729)
- Saint Nicolas Planas : la vie pleine de prodiges d’un homme simple (+1932)
- Edvige Carboni, la mystique de Pozzomaggiore (+1952)
- Lacrimations et images miraculeuses
- La dévotion à la Sainte Face
- Notre-Dame du Perpétuel Secours (XIIIe siècle)
- Le crucifix deux fois miraculeux de l’église Saint-Marcel (1519)
- La Tilma de Guadalupe (1531)
- Symbole national russe, Notre Dame de Kazan multiplie les miracles (1579)
- Catherine Labouré et la médaille miraculeuse (1830)
- Le crucifix de Limpias donne à voir l’agonie de Jésus (1919)
- L’image de la Sainte Face du Christ saigne par trois fois à Airola (1947)
- Les larmes de Marie coulent à Syracuse (1953)
- Teresa Musco, le salut par la Croix (+1976)
- Les exsudations d’huile de Myrna et de l’Icône de Soufanieh (1982)
- Le mystérieux visage de Sierck-les-Bains (1985)
- L’icône de Seidnaya exhale un merveilleux parfum (1988)
- Notre-Dame pleure dans les mains de l’évêque (1995)
- Stigmates
- Les stigmates de saint François, blessures d’amour (1224)
- Bienheureuse Christine de Stommeln, épouse mystique de Jésus Christ (1257)
- Jésus crucifié dans le cœur de sainte Claire de Montefalco (+1308)
- Tout un couvent tiré vers le Ciel avec la vénérable Lukarde d’Oberweimar (+1309)
- Marie Lopez de Rivas reçoit la couronne d’épines (+1640)
- Florida Cevoli, la croix au cœur (+1767)
- Gemma Galgani participe à la Passion du Christ (1899)
- La bienheureuse Maria Grazia Tarallo, stigmatisée et mystique extraordinaire (+ 1912)
- Saint Padre Pio, « crucifié d’amour » (1918)
- Hélène Aiello, une « âme eucharistique » (+1961)
- Un triduum au côté de Jésus souffrant (1987)
- Un Jeudi saint à Soufanieh (2004)
- Miracles eucharistiques
- Jésus se laisse voir dans l’eucharistie à Lanciano (750)
- La dernière communion de saint Bonaventure (1274)
- Une hostie vient à elle (1333)
- L’hostie incombustible de Morrovalle (1560)
- Les hosties de Faverney miraculeusement sauvées du feu (1608)
- Les hosties volées de Sienne : « Il y a la Présence » (1730)
- Patierno, où les hosties ont été révélées par des lumières inexplicables (1772)
- Jésus se penche hors de l’ostensoir et bénit les priants (1822)
- L’Enfant Jésus de Prague dans une hostie (1898)
- Le visage de Jésus apparaît sur l’hostie dans l’ostensoir (1902)
- Un tsunami recule devant le Saint Sacrement (1906)
- À Buenos Aires, le muscle cardiaque de Jésus sous le microscope (1996)
- Confirmation à Tixtla de la réelle présence de Jésus dans l’Eucharistie (2006)
- Le miracle eucharistique de Sokolka (2008)
- Nouveau signe de la Présence réelle de Jésus dans l’Eucharistie à Legnica (2013)
- Reliques
- Le voile de Véronique, dit voile de Manoppello
- Le Linceul de Turin a été pendant des siècles la seule image en négatif au monde
- L’image du Linceul de Turin ne peut s’expliquer que par la Passion et la Résurrection de Jésus
- L'exceptionnelle histoire de la Tunique d'Argenteuil (30)
- Saint Louis et les attributs de la Passion (+1270)
- Les reliques de trois Rois mages à Cologne (1164)
- La procession du reliquaire de saint Ange à Licata (+1220)
- Les puissantes reliques de la mystérieuse sainte Philomène (1802)
- Le sauvetage miraculeux du Linceul de Turin (1997)
- Étude comparative des sangs des reliques du Christ
- Des juifs découvrent le Messie
- Saint Paul
- David Paul Drach
- François-Xavier Samson Libermann, israélite converti à la foi en Jésus-Christ (1824)
- Destiné à être rabbin, François Jacob Libermann devient prêtre (1826)
- Théodore Ratisbonne a trouvé « la paix, la lumière et le bonheur » (1827)
- Le rendez-vous mystique d’Alphonse Ratisbonne (1842)
- Eugenio Zolli
- Max Jacob : conversion inattendue d’un artiste libertin (1909)
- Edith Stein « unie au Christ, telle une catholique, et à son peuple telle une juive » (1921)
- Un juif découvre le Messie à la suite de la guérison miraculeuse de sa mère : Patrick Elcabache (1958)
- Olivier : de Pessah à la Pâque chrétienne (2000)
- Aron Jean-Marie Lustiger, un choix de Dieu (+2007)
- Roy Schoeman
- Conversions de musulmans
- Des conversions au Christ massives en terre d’islam (XXe et XXIe siècle)
- Nicolas Nazzour (Soufanieh, après 1981)
- Joseph Fadelle témoigne de sa conversation et des persécutions (1987)
- Afshin demande à Jésus de se révéler à lui (1990)
- Il a rencontré Jésus en cherchant Muhammad (1990)
- Le chemin de Selma vers le baptême (1996)
- Soumia, sauvée par Jésus en entendant les cantiques de Noël (2003)
- Comment le Christ s’est révélé dans la vie d’Aïsha (2004)
- Amir choisit le Christ, même au risque de dormir dans la rue (2004)
- Souad Brahimi, amenée à Jésus par Marie (2012)
- Imène, sauvée des démons par Jésus-Christ (2016)
- La « course-poursuite » de Khadija avec Dieu (2023)
- Conversions de bouddhistes
- Conversions d'athées
- La conversion inespérée d’un bourreau de la Terreur (1830)
- La Vierge Marie sauve Bartolo Longo des griffes de Satan (1877)
- Saint Charles de Foucauld (1886)
- La conversion de Paul Claudel : un grand poète bouleversé pour la vie (1886)
- De l’agnosticisme à l’abbaye de la Trappe de Chimay (1909)
- Alessandro Serenelli, l’assassin sauvé par sa victime (1909)
- Madeleine Delbrêl, éblouie par Dieu (1924)
- C.S. Lewis, converti malgré lui (1931)
- Le jour où André Frossard a rencontré le Christ à Paris (1935)
- Une enfant obtient la conversion du président franc-maçon espagnol (1940)
- La rédemption de Jacques Fesch (1955)
- Enquêtant sur la résurrection du Christ, un journaliste athée se convertit (1981)
- Gunman, du crime au Christ (1983)
- De la mort à la vie : le cheminement du docteur Nathanson (1996)
- Une vision de l'enfer sauve John Pridmore (XXe s)
- Un rappeur de MC Solaar converti par la Passion du Christ (XXe s)
- Le père Sébastien Brière, converti à Medjugorje (2003)
- Carl découvre le brasier d'amour du Christ (2009)
- Franca Sozzani, la « papesse de la mode » qui voulait rencontrer le pape (2016)
- Nelly Gillant, du monde des morts à la foi catholique (2018)
- Au Saint-Sépulcre, le Christ se révèle à Éric-Emmanuel Schmitt, qui écrit pour le raconter (2022)
- Témoignages de rencontres avec le Christ
- Les expériences de mort imminente (EMI) confirment la doctrine sur les fins dernières
- L’EMI de sainte Christine l’Admirable, source de conversion au Christ (1170)
- Jésus parle à Alphonse de Liguori qui, en retour, promet d’entrer dans les ordres (1723)
- Amazing Grace : sauvé du naufrage, et de son péché (+1807)
- L’illumination spirituelle de Louise de Marillac (1623)
- Bienheureuse Dina Bélanger : aimer et laisser faire Jésus et Marie (+1929)
- Simone Weil rencontre le Christ (1938)
- Gabrielle Bossis, « Lui et moi » (+1950)
- La rencontre du Christ et de Jérôme Lejeune (1967)
- La conversion d'André Levet en prison (1969)
- Voyage entre paradis et enfer, une « expérience de mort imminente » (1971)
- Déclaré mort, Ian McCormack rencontre Jésus (1982)
- Le message du Christ à Myrna Nazzour (1984)
- Alice Lenczewska : dialogues avec Jésus (1985)
- Vassula et La Vraie Vie en Dieu (1985)
- Nahed Mahmoud Metwalli, de persécutrice à persécutée (1987)
- Le surnaturel se déploie dans la vie d’Alan Ames (1993)
- Tête-à-tête avec Jésus (1994)
- Le verset de la Bible qui a converti Élie (2000)
- Johann accepte Jésus dans sa vie (2004)
- Expérience mystique sur le chemin de Compostelle (2008)
- Becket Cook rencontre le Christ et change de vie (2009)
- Chantal, invitée à la cour céleste (2017)
- Histoires providentielles
- L’intuition surhumaine de saint Pacôme le Grand (+346)
- Saint Martin est sauvé du feu par la prière (386)
- Ambroise de Milan retrouve les corps des martyrs Gervais et Protais (386)
- Dieu promet en songe à Monique la conversion de son fils (+387)
- Les prédictions et protections de Germain d’Auxerre pour sainte Geneviève (446)
- Apt : les reliques de sainte Anne retrouvées par miracle (792)
- La couronne de saint Étienne de Hongrie (997)
- Saint Géraud et le miracle des fruits à Braga (+1109)
- Il doute de la Providence : Dieu lui envoie sept étoiles pour éclairer sa route (1132)
- La réconciliation surnaturelle du duc d’Aquitaine (1134)
- Dieu charge le petit Bénézet de bâtir un grand pont (1177)
- Zita et le miracle du manteau (XIIIe)
- La Guadalupe espagnole (1326)
- Jeanne d’Arc, la plus belle histoire du monde (+1431)
- Jean de Capistran sauve l’Église et l’Europe (1456)
- Une musique céleste réconforte Elisabetta Picenardi sur son lit de mort (+1468)
- Et une grande lumière ouvrit la porte de son cachot… (1520)
- Le miracle de la transmission de la foi dans l’Église cachée japonaise (1587-1853)
- Jeanne de Chantal et François de Sales : une rencontre préparée par Dieu (1604)
- L’étrange aventure d’Yves Nicolazic (1623)
- Julien Maunoir apprend miraculeusement le breton (1626)
- Pierre de Keriolet : avec Marie, nul ne se perd (1636)
- La prière de sœur Marie des Anges sauve deux fois Turin (1696)
- La conversion autonome de la Corée (XVIIIe)
- Le chapelet et l’officier de la Grande Armée (1808)
- André Bobola prédit la renaissance de la Pologne (1819)
- Vincent de Paul révèle sa vocation à Catherine Labouré (1824)
- Le poème prophétique qui annonçait Jean-Paul II (1840)
- Pierre-Julien Eymard prie et Marie garde le collège (1851)
- Grigio, l’étrange chien de Don Bosco (1854)
- Les flammes purificatrices de Marie-Thérèse de Soubiran (1861)
- Thérèse de Lisieux sauve de la ruine un carmel italien (1910)
- Thérèse de Lisieux, protectrice de ceux qui combattent (1914-1918)
- Une image de la Vierge Marie à l’épreuve des bombes (1921)
- Perdue pendant plus d’un siècle, une icône russe réapparaît (1930)
- Du chemin des vaches à la communauté du Chemin Neuf (1940)
- Notre Dame de la Clarté sauve sa chapelle bretonne (1944)
- Au milieu des ruines, la cellule de Léopold Mandic est intacte (1944)
- En 1947, une croisade du rosaire libère l’Autriche des Soviétiques (1946-1955)
- La découverte du tombeau de saint Pierre à Rome (1949)
- Il était censé mourir de froid dans les geôles soviétiques (1972)
- Un agent secret protégé par Dieu (1975)
- La lave s’arrête aux portes de l’église (1977)
- Une main protectrice sauve Jean-Paul II avec des répercussions providentielles (1981)
- Marie qui défait les nœuds : le cadeau du pape François au monde (1986)
- La découverte de Notre-Dame de France par Edmond Fricoteaux (1988)
- Un évêque vietnamien tiré de prison par Marie (1988)
- La chute du communisme (1989)
- Jésus retarde le décès de Lizzie (1990)
- Les miracles de sainte Julienne (1994)
- Frappée par la foudre, Gloria se tient aux portes de l’enfer (1995)
- L’huile merveilleuse coule à l’abbaye de Bonneval (1996)
- Le lancement des « Vierges pèlerines » dans le monde a été permis par la Providence de Dieu (1996)
- La découverte providentielle des bâtiments du Centre international Marie de Nazareth (2000)
- La dépouille de sainte Kyranna miraculeusement retrouvée 250 ans après son martyre (2011)
- Un couvent miraculeusement protégé de tous les maux (2011-2020)
- Retour de l’anneau de Jeanne d’Arc en France : une affaire providentielle (2016)
- La conversion de Fabrice Amedeo, au beau milieu de l’océan (2025)
Les moines
n°608
Bologne (Italie)
XVe siècle
Frère Corradino donne tout et mendie pour donner davantage
Au XVe siècle, le père Corradino Arioni est un moine du couvent dominicain de Bologne (nord de l’Italie). Sa science, sa pénitence, sa piété, son désintéressement et sa charité prudente font tant de bien autour de lui que ses frères en religion lui confient le gouvernement du couvent. Cette charge lui permet de faire rayonner le Christ autour de la communauté, car le prieur présente à ses frères un visage si souriant de la vertu chrétienne qu’une émulation vers les actes de miséricorde matérielle comme spirituelle fait briller la communauté d’une réputation qu’elle conservera longtemps. Les archives de l’ordre dominicain en font mémoire le 8 avril.

© Shuterstock/Billion Photos
Les raisons d'y croire :
- Alors qu’il est encore jeune homme, les études de droit qu’entreprend Corradino à l’université de sa ville, célèbre dans toute l’Europe, vont de succès en succès. Il en franchit tous les degrés jusqu’au doctorat, qu’il obtient plus brillamment encore. Comme le jour solennel de la remise des honneurs dus au grade de docteur approche, Corradino y renonce volontairement, leur préférant le Christ, qu’il décide de suivre désormais.
- L’ordre des Frères prêcheurs est la voie par laquelle il veut s’unir au Dieu qu’il aime. Il prononce les vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance, auxquels il sera fidèle jusqu’à sa mort en 1468, en vivant dans l’esprit de pénitence, d’étude et de prédication montré par saint Dominique.
- Les efforts qu’implique le mode de vie religieux exemplaire du frère Corradino sont dirigés et soutenus par des vues surnaturelles, car c’est pour témoigner à Dieu qu’il l’aime que le religieux agit ainsi, et pour le faire aimer par autrui. Une telle abnégation au quotidien ne passe pas inaperçue, malgré la discrétion de celui qu’elle pare, auprès de ses frères en religion. Les pères du couvent élisent donc à l’unanimité le frère Corradino prieur.
- Dieu le gratifie, parmi d’autres dons, de celui des larmes : on voit souvent, dira-t-on de lui, que tel sermon sur la Passion du Christ ou tel autre sur les tourments qu’endura un martyr lui font répandre d’abondantes larmes, au point que l’on sait combien son cœur est attaché à Dieu, puisqu’il se liquéfie ainsi à l’extérieur lorsque l’on parle devant lui des témoignages de l’amour divin.
- On ne peut séparer la charité envers Dieu de celle à rendre au prochain : le Christ les unit toutes deux (cf. Mt 22,34-40), parce que la première est à la racine de l’autre. Aussi la première ne peut-elle être authentique si la seconde fait défaut. Le frère Corradino le sait bien, non seulement intellectuellement (c’est-à-dire par le raisonnement), mais encore par l’expérience : l’amour voué à Dieu se vérifie par le soin donné au prochain. Aussi se prive-t-il de sa subsistance quotidienne, qu’il apporte aux étudiants pauvres de l’université. Il pourvoit aussi, à partir de ses propres ressources, au salaire de certains enseignants.
- Il apporte également ses secours aux jeunes filles indigentes jusqu’à ce qu’elles puissent trouver une situation stable, et il subvient chaque fois à la dot nécessaire dans le cas où elles se marient. Les habitants de Bologne témoigneront que bien des filles qui se perdaient dans la prostitution ont pu être relevées grâce à l’aide du frère Corradino. Tout ce qu’il peut accomplir pour libérer les uns comme les autres des précipices moraux auxquels la misère conduit, il ne manque pas de le mettre en œuvre.
- Pour trouver les fonds nécessaires à sa charité, il ne rougit pas d’aller mendier par les rues de la ville, où tous le connaissent en raison de la haute noblesse de sa famille, ce qui lui rend la tâche plus difficile. La vanité humaine adule facilement celui qui relève d’un rang social supérieur quand il en présente les marques visibles, mais n’a souvent que mépris pour lui si son extérieur est semblable à celui des pauvres gens. Parfois même une secrète envie y trouve occasion, sans crainte de représailles, de se venger par un mépris affiché, par des quolibets ou par une brutale rebuffade de la supériorité morale de celui qui s’est volontairement abaissé socialement. Le frère Corradino souffre certainement souvent de ces attitudes mesquines. L’humilité est donc chez lui un trait remarquable, tout autant que la charité qui le pousse à veiller sur celui qui est dans la peine pour lui venir en aide.
Synthèse :
C’est dans la célèbre, heureuse et riche cité de Bologne (nord de l’Italie) que naît le bienheureux Corradino, de la noble famille des Arioni. Après avoir pris l’habit dans le couvent dominicain de sa patrie, il se montre un novice exemplaire non seulement dans les choses importantes, mais aussi dans les moindres. Il est très appliqué à l’office choral – il s’agit des psaumes chantés au chœur, dans l’église, en louange rendue à Dieu – et porte toujours le cœur élevé vers Dieu au point que, même au cours des travaux manuels, il poursuit en esprit sa prière.
Quand, après sa mort, l’enquête sur les vertus sera ouverte, nul au couvent ne se souviendra de l’avoir entendu prononcer une parole de trop : Corradino sait en effet que la mesure dans la conversation est un moyen efficace pour éviter les fautes de vanité et de médisance. « Il devint ainsi un miroir très pur en lequel chacun pouvait voir se refléter la vraie pureté, modestie, humilité et obéissance religieuses » (Il diario domenicano, p. 203, C).
Une fois élu prieur, Corradino montre en cette charge un vif et noble zèle qu’accompagne toujours une grande prudence. Son œuvre la plus fameuse est la réalisation de la magnifique bibliothèque du couvent de Bologne, qu’il enrichit d’ouvrages rares et de manuscrits remarquables. Il ne se départit pas de son ancienne austérité envers lui-même, qu’il offre malgré lui en exemple à ses frères – exemple qui leur rend plus aisée l’observance de la règle. Il se montre à leur égard toujours empreint d’une douceur paternelle. Ces deux stimulants – le bon exemple du prieur et sa charité envers tous – agissent si fort sur les volontés des religieux que ces derniers s’attachent à vivre l’Évangile avec exigence. Ainsi, sous son gouvernement, la communauté fait année après année de grands progrès spirituels. Le nombre des frères grandit au point qu’un an après la mort du père Corradino, les religieux décident d’agrandir le couvent.
C’est sous le priorat du père Corradino que la peste sévit à Bologne. Le religieux, estimant que les jeunes frères de son couvent sont plus utiles à l’ordre qu’aux besoins du couvent, les envoie se mettre à l’abri en un lieu sûr. Lui demeure au couvent pour consoler les frères malades et soulager leurs souffrances par les soins nécessaires. Il s’occupe aussi des malheureux habitants voisins. Tous sont contagieux mais il n’en fait pas cas, risquant sa propre vie à chaque visite.
Chargé enfin autant d’années que de mérites, il meurt à Bologne durant le carême de l’année 1468. Il est enterré dans le cloître du couvent, près des dépouilles des premiers frères prêcheurs. Sa réputation de sainteté est telle qu’à la suite de l’enquête menée à son sujet à Bologne, tous ses biographes, tant ses contemporains que de plus récents, l’honorent du titre de « bienheureux ».
Docteur en philosophie, Vincent-Marie Thomas est prêtre.
Au-delà des raisons d'y croire :
À Bologne, le visiteur d’aujourd’hui peut toujours se recueillir auprès d’un des plus grands trésors de la ville, conservé jalousement dans l’église des Dominicains : les os de leur fondateur, saint Dominique. Le sculpteur et architecte Nicola Pisano réalise à partir de 1264 le magnifique tombeau, dont les bas-reliefs illustrent la vie du grand patriarche. Du temps du frère Corradino, le chef du saint avait déjà été séparé du corps et placé dans un imposant reliquaire, dessiné et ciselé en 1383 par l’artiste bolognais Jacopo Roseto. De 1377 à 1413, les travaux de construction de la chapelle Saint-Dominique s’étendent : c’est en ce lieu que la communauté vient prier chaque soir aux pieds de leur père après les complies – le dernier office chanté au chœur. C’est là que nous pouvons venir, nous aussi : l’endroit nous sera familier, bien que le décor de la chapelle ait été modifié au XVIIIe siècle.
En 1469, le sarcophage de Nicola Pisano est placé dans la construction architectonique déjà existante, embellissant le tombeau de saint Dominique. Le projet est confié au sculpteur Nicola dell’Arca (Nicola da Puglia). Il est plus que probable que la réalisation d’un tel monument à la gloire du fondateur de l’ordre, voulu par les sénateurs de la ville (c’est-à-dire le conseil souverain de la cité) témoigne de la reconnaissance émue de toute la cité envers un des meilleurs fils de saint Dominique, le père Corradino, décédé un an plus tôt.
Aller plus loin :
Domenico Maria Marchese, O.P., Sagro diario domenicano, vol. II (Mesi di Marzo e Aprile), Napoli, 1670, p. 203-204. Disponible en ligne.
En savoir plus :- Stefano Bottari, L’Arca di S. Domenico in Bologna, Bologna, Patron, 1964.
- Une vidéo présente (en italien) la célèbre bibliothèque du couvent de Bologne, ouverte au public. Le bibliothécaire actuel en raconte l’histoire et en détaille le patrimoine toujours remarquable, malgré les confiscations advenues lors des épisodes de suppression des congrégations religieuses (au XIXe siècle).
LES RAISONS DE LA SEMAINE
Les moines ,
La profondeur de la spiritualité chrétienne

Saint Benoît, patriarche des moines d’Occident
Les moines ,
La profondeur de la spiritualité chrétienne

San Benedetto, patriarca dei monaci d'Occidente
Les moines ,
La profondeur de la spiritualité chrétienne

San Benito, patriarca del monacato occidental
Les moines ,
La profondeur de la spiritualité chrétienne

Saint Benedict, fathe of Western monasticism
Les saints ,
Guérisons miraculeuses ,
Corps conservés des saints ,
Reliques

Les 29 349 miracles de saint Charbel Maklouf
Les saints ,
Guérisons miraculeuses ,
Corps conservés des saints ,
Reliques

I 29.349 miracoli di San Charbel Maklouf
Les saints ,
Guérisons miraculeuses ,
Corps conservés des saints ,
Reliques

The more than 33,000 miracles of Saint Charbel Maklouf
Les saints ,
Guérisons miraculeuses ,
Corps conservés des saints ,
Reliques

Los 29.349 milagros de San Chárbel Maklouf
Les moines ,
Les saints ,
Des miracles étonnants ,
Guérisons miraculeuses ,
Bilocations ,
Stigmates
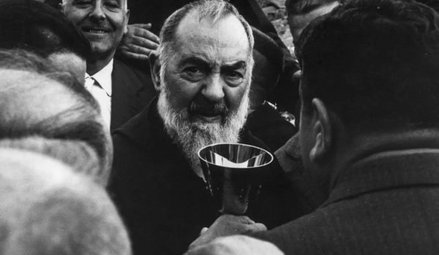
Saint Padre Pio : les merveilles de Dieu à travers « un humble frère qui prie »
Les moines ,
Les saints ,
Des miracles étonnants ,
Guérisons miraculeuses ,
Bilocations ,
Stigmates
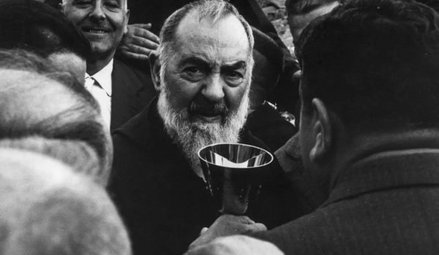
San Padre Pio: le meraviglie di Dio attraverso "un povero frate che prega"
Les moines ,
Les saints ,
Des miracles étonnants ,
Guérisons miraculeuses ,
Bilocations ,
Stigmates
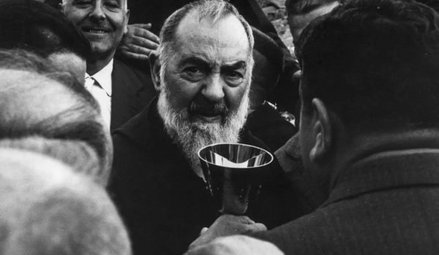
Saint Pio of Pietrelcina: How God works wonders through "a poor brother who prays"
Les moines ,
Les saints ,
Des miracles étonnants ,
Guérisons miraculeuses ,
Bilocations ,
Stigmates
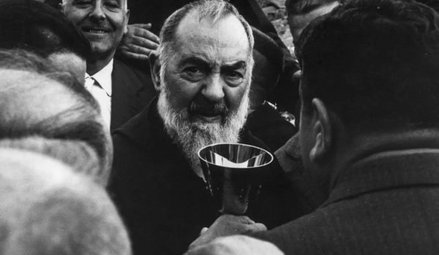
San Padre Pío: las maravillas de Dios a través de "un humilde hermano que reza".
Les moines ,
Les saints

Saint Bruno le Chartreux, miracle de la vie cachée
Les moines ,
Les saints

San Bruno della Certosa, miracolo della vita nascosta
Les moines ,
Les saints

San Bruno Cartujo, milagro de la vida oculta
Les moines ,
Les saints

Saint Bruno the Carthusian: the miracle of a hidden life
Les moines ,
Des miracles étonnants

Bienheureux Ange-Augustin, le carme couronné de fleurs
Les moines ,
Des miracles étonnants

Il beato Angelo Agostino, il carmelitano coronato di fiori
Les moines ,
Des miracles étonnants

Blessed Angelo Agostini Mazzinghi: the Carmelite with flowers pouring from his mouth (d. 1438)
Les moines ,
Des miracles étonnants

El Beato Ángel Agustín, el carmelita coronado de flores
Les moines ,
Les visionnaires ,
Des miracles étonnants

Les prophéties réalisées du moine Abel pour la Russie
Les moines ,
Les visionnaires ,
Des miracles étonnants

Le profezie avveratesi del monaco Abele per la Russia
Les moines ,
Les visionnaires ,
Des miracles étonnants

Las profecías cumplidas del monje Abel para Rusia
Les moines ,
Les visionnaires ,
Des miracles étonnants

Monk Abel of Valaam's accurate prophecies about Russia (d. 1841)
Les moines ,
Des miracles étonnants ,
Guérisons miraculeuses ,
Corps conservés des saints

Les prophéties du père Païssios, du mont Athos
Les moines ,
Des miracles étonnants ,
Guérisons miraculeuses ,
Corps conservés des saints

Le profezie di padre Paisios, dal Monte Athos
Les moines ,
Des miracles étonnants ,
Guérisons miraculeuses ,
Corps conservés des saints

Las profecías del Padre Païssios, del Monte Athos
Les moines ,
Des miracles étonnants ,
Guérisons miraculeuses ,
Corps conservés des saints

The prophecies of Saint Paisios of Mount Athos
Les moines ,
La profondeur de la spiritualité chrétienne

Saint Antoine du désert, le « père des moines »
Les moines ,
La profondeur de la spiritualité chrétienne

Sant'Antonio del Deserto, il "padre dei monaci".
Les moines ,
La profondeur de la spiritualité chrétienne

San Antonio del Desierto, el "padre de los monjes".
Les moines ,
La profondeur de la spiritualité chrétienne

Saint Anthony of the Desert, a father of monasticism
Les moines ,
Corps conservés des saints

La mort étonnante du père Emmanuel de Floris
Les moines ,
Corps conservés des saints

La morte sorprendente di padre Emmanuel de Floris
Les moines ,
Corps conservés des saints

La sorprendente muerte del Padre Emmanuel de Floris
Les moines ,
Corps conservés des saints

The surprising death of Father Emmanuel de Floris
Les moines ,
Les saints

Les Pères du désert
Les moines ,
Les saints

I Padri del deserto
Les moines ,
Les saints

Los Padres del Desierto
Les moines ,
Les saints

The Desert Fathers
Les moines ,
Guérisons miraculeuses

Capucin thaumaturge, bienheureux Marc d’Aviano
Les moines
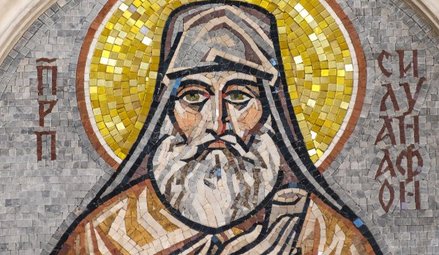
La prière perpétuelle de Silouane de l’Athos
Les moines

L’extraordinaire frère Toufik
Les moines ,
Une vague de charité unique au monde

Frère Corradino donne tout et mendie pour donner davantage
Les moines ,
Les saints

Antonin de Florence : moine, prophète et archevêque
Les moines
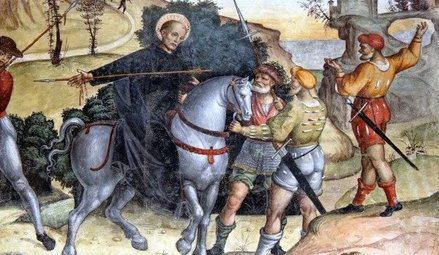
Un abbé en prière pour son siècle : Mayeul de Cluny
Les moines ,
Les saints








